Introduction à la production biologique de pommes de terre
La production biologique durable de pommes de terre dépend non seulement d’une gestion appropriée pendant la croissance des cultures, mais aussi de la création de conditions de croissance favorables. Cela exige des connaissances sur les besoins de croissance des pommes de terre.
Besoins de croissance des pommes de terre
Les plantes de pomme de terre préfèrent des températures entre 10 et 22 ⁰C avec une moyenne de 15 ⁰C. C’est pourquoi, au Cameroun, les pommes de terre sont cultivées à des altitudes supérieures à 800 mètres.
La pomme de terre a une demande en eau assez élevée. La culture nécessite une pluviométrie bien répartie de 500 à 750 mm à tous les stades de croissance pendant une période de 3 à 4,5 mois. La pomme de terre est particulièrement sensible aux longues périodes humides ou sèches pendant la floraison et la formation des tubercules. L’engorgement ainsi que le sol sec ne sont pas favorables à la production de tubercules. Si la pomme de terre est cultivée pendant les périodes sèches ou dans des zones où les précipitations sont faibles ou irrégulières, l’irrigation est généralement nécessaire.
Les sols légers à moyens, les sols meubles riches en matière organique, avec une profondeur appropriée et un pH de 5,5 à 7 sont idéaux pour la pomme de terre. Les sols pour la production de pommes de terre doivent être bien drainés pour éviter l’engorgement et en même temps avoir une bonne capacité de rétention d’eau pour assurer un approvisionnement régulier en eau. Les sols trop caillouteux, peu profonds, compactés et mal drainés ne conviennent pas à la production de pommes de terre.
Sur les sols plus légers, les tubercules développent généralement une forme et une couleur plus belles ainsi que des yeux plus plats. Sur les sols lourds, les tubercules ont une peau plus lisse et la présence de tavelure est plus faible. Les sols sablonneux à séchage rapide entraînent des peaux plus rugueuses et roussâtre ainsi qu’une infection par la tavelure.
Les sols dont le pH est inférieur à 5,0 produiront des tubercules de mauvaise qualité et une croissance anormale, tandis qu’un pH élevé causera des problèmes avec la tavelure commune. En raison de leur faible teneur en éléments nutritifs et de leur faible capacité d’échange de base, les sols latéritiques acides répandus sont naturellement peu fertiles et ont un faible potentiel de production. Cependant, des mesures appropriées de gestion de la fertilité du sol, telles que l’apport de matière organique au sol, l’augmentation du pH du sol par chaulage, l’application de compost et l’irrigation, les rendent aptes à la culture.
Choix du site
- Les pommes de terre doivent être cultivées en plein champ et non à l’ombre des arbres. Des endroits bien aérés permettent à la culture de sécher rapidement après la pluie ou la rosée, réduisant ainsi le risque d’infection par des maladies fongiques.
- Les champs légèrement inclinés sèchent et s’écoulent plus rapidement que les champs qui se trouvent dans le bassin de la vallée. Les champs de pommes de terre ne doivent pas être trop raides pour éviter l’érosion du sol. Si elles sont cultivées sur des pentes, les buttes doivent suivre les courbes de niveau.
- Les sols destinés à la culture de pommes de terre doivent être exempts de flétrissement bactérien et de nématodes (pour plus d’informations sur les symptômes, voir chapitre 2.10.1.1.). Choisir un champ où la pomme de terre ou d’autres plantes de la famille des Solanaceae telles que la tomate et le poivron n’ont pas été plantées au cours des 3 dernières années assure des sols exempts de parasites et de maladies dans la plupart des cas.
- L’accès à l’eau pour l’irrigation permet la production hors saison et constitue un grand avantage dans la production de pommes de terre et de légumes.
- Les routes praticables à proximité simplifient le transport de la récolte.
Période de croissance et saisons de croissance
- Le cycle de production moyen des variétés de pommes de terre couramment cultivées en Afrique subsaharienne varie de 90 à 120 jours. Plus le cycle de production est court, moins il y a de risques de pertes dues au mildiou et à l’attaque des ravageurs.
- Si la pomme de terre est cultivée sans irrigation, la saison idéale au Cameroun est de mars à juin, lorsque des pluies modérées assurent de bonnes conditions de croissance. En juillet et août, lorsque les pluies abondantes se produisent presque tous les jours, la pression de la maladie peut être trop élevée pour la production biologique de pommes de terre.
- Il est également possible de cultiver des pommes de terre de la mi-août à fin novembre.
- Lorsque l’irrigation est disponible, il est préférable de cultiver les pommes de terre pendant la période sèche de novembre à mars, lorsque la pression du mildiou est faible.
Discussion sur la période de croissance idéale pour la pomme de terre
Discutez avec les agriculteurs des avantages et des contraintes des différentes périodes de culture en tenant compte des conditions climatiques, de la pertinence de la pomme de terre par rapport à d'autres cultures, du placement de la culture dans la rotation, du prix du marché des tubercules de pomme de terre et d'autres aspects.
Approche de base
- Les pratiques agricoles conventionnelles intensives reposent principalement sur les engrais minéraux pour fournir des éléments nutritifs aux cultures. Toutefois, la gestion de la fertilité des sols ne se limite ni à l’ajout d’engrais ni à l’obtention de rendements agricoles élevés. Il s’agit de construire un sol riche, stable et vivant. C’est pourquoi, en premier lieu, les agriculteurs biologiques accordent beaucoup d’attention à l’accroissement de la fertilité du sol à moyen et à long terme.
- La matière organique du sol est un élément clé de la fertilité naturelle du sol, car elle est le moteur de l’activité biologique du sol. Les agriculteurs biologiques parlent de nourrir le sol, afin que le sol puisse nourrir les plantes de manière équilibrée. Pour nourrir le sol, les agriculteurs biologiques appliquent des matières “organiques” au sol. Il s’agit notamment de compost, de fumier animal, de matières végétales vertes ou d’autres matières organiques. La nutrition des plantes en agriculture biologique repose idéalement sur une saine gestion de la matière organique du sol ou de l’humus en préservant ou même en augmentant la teneur en matière organique du sol.
- Maintenir la fertilité des sols peut être une tâche difficile dans des conditions climatiques subtropicales et tropicales, où des températures élevées et des conditions humides ou sèches favorisent une dégradation rapide de la matière organique dans le sol et où le risque d’érosion du sol est élevé.
- Les agriculteurs biologiques visent également à réduire au minimum la dépendance à l’égard des sources externes d’éléments nutritifs comme les engrais commerciaux. Par conséquent, ils recyclent tout le matériel végétal et le fumier animal de la ferme pour nourrir leurs sols. Un recyclage efficace des matières végétales et animales est indispensable pour les cultures sur des terres cultivées de manière intensive et sur des sols à faible teneur en matières organiques.
- La gestion biologique de la fertilité des sols peut être considérée comme une approche en trois étapes, chaque étape constituant la base de la suivante. L’objectif est d’encourager le rajeunissement naturel du sol et de minimiser l’application d’engrais étrangers, d’amendements du sol et d’eau d’irrigation.
Étape 1 – Conserver le sol, la matière organique et l’eau des pertes.
Étape 2 – Améliorer la teneur en matière organique du sol.
Étape 3 – Compléter les besoins en éléments nutritifs et améliorer les conditions de croissance en appliquant des amendements au sol.
Idéalement, les agriculteurs biologiques accordent beaucoup d’attention à l’application correcte et efficace des étapes 1 et 2 afin d’économiser sur les coûts des engrais et autres compléments et de prévenir d’éventuels impacts négatifs sur l’écosystème de l’exploitation.
Première étape
Dans un premier pas, les agriculteurs biologiques visent à établir un sol stable et moins vulnérable comme fondement de la gestion des sols fertiles. Ils le font en :
- Empêcher le sol d’être érodé par l’eau de pluie ou le vent en le recouvrant le plus possible. Ils recouvrent le sol avec des plantes vivantes (appelées cultures de couverture), en particulier dans les cultures vivaces ou avec du matériel végétal mort (appelé paillage). Ils creusent et construisent des barrières à travers la pente pour réduire la vitesse de déplacement de l’eau de pluie le long de la pente.
- Pour minimiser la perturbation du sol, un nombre croissant d’agriculteurs biologiques du monde entier pratiquent la culture superficielle du sol, maintiennent une couverture protectrice à la surface du sol et permettent une préparation précoce du sol avant de fortes pluies. Ces pratiques préservent la structure du sol, réduisent le risque de compactage du sol, augmentent l’infiltration de l’eau, réduisent le ruissellement et l’évaporation et améliorent ainsi le stockage de l’eau.
Deuxième étape
Dans un deuxième pas, l’objectif est de construire un sol actif avec une bonne structure, qui peut stocker de l’eau et fournir des éléments nutritifs aux plantes. Les agriculteurs biologiques y parviennent en appliquant des pratiques qui améliorent la teneur en matière organique du sol et augmentent l’activité des organismes du sol. De telles pratiques comprennent :
- Culture d’engrais verts : Les engrais verts, principalement des légumineuses, sont cultivés pour les grandes quantités de matériel végétal frais qu’ils produisent. Ces plantes sont ensuite coupées et incorporées au sol pour nourrir les organismes du sol et fournir des nutriments aux cultures qui suivent. La culture de plantes riches en azote pour l’utilisation primaire comme engrais de ferme peut sembler déraisonnable, mais c’est une mesure très efficace pour améliorer la fertilité du sol et la nutrition des cultures. Les engrais verts peuvent également être coupés et donnés au bétail selon les besoins, et le fumier de haute qualité peut être composté plus tard pour la production végétale. Les racines et la litière des engrais verts restent dans ou sur le sol après la coupe de la biomasse aérienne et offrent une protection du sol contre les éléments tout en contribuant à l’amélioration de la fertilité du sol.
- Inter-culture de cultures de couverture comme le haricot velours, la tithonia, le lablab et d’autres comme paillis vivant. Les cultures de couverture sont régulièrement coupées avant qu’elles ne soient trop en concurrence avec la culture principale.
- Paillage avec des matériaux particulièrement difficiles à composter ou boisés, qui se décomposent lentement. Celles-ci contribuent à l’augmentation de la matière organique du sol avec le temps.
- Cultiver des arbres et des arbustes pour l’agroforesterie : Les arbres et arbustes peuvent être cultivés dans les champs avec les cultures, sur les bords des champs, ou sur les parcelles en jachère, où ils sont régulièrement taillés et les branches utilisées comme paillis.
- Compostage : La production de compost est une autre méthode biologique typique avec une valeur élevée pour l’amélioration de la fertilité des sols. Les résidus de culture et autres matières végétales, ainsi que le fumier animal sont préparés d’une manière spécifique et transformés en amendements de fertilité du sol de grande valeur. L’introduction de bétail à la ferme pour l’approvisionnement régulier en fumier et en litière pour la production de compost est encouragée afin d’augmenter les sources de biomasse. En outre, les agriculteurs et les éleveurs peuvent obtenir des synergies en échangeant le fourrage du bétail (par exemple, des engrais verts ou de la végétation en jachère ou des engrais verts) et le fumier du bétail - une situation gagnant-gagnant.
- L’application de fumier animal : Le fumier animal peut être appliqué directement sur le sol sans compostage. Cependant, l’expérience montre que le compostage préalable des fumiers, avec les résidus végétaux, donne les meilleurs résultats pour la croissance des plantes. L’épandage de fumier animal frais sur le sol comporte certains risques, par exemple la contamination des parties comestibles des plantes par des bactéries potentiellement nocives, par exemple Escherichia coli, et l’”effet de brûlure” sur les cultures qui pourrait en résulter.
- Utiliser des engrais liquides pour surmonter les pénuries temporaires d’éléments nutritifs et stimuler la croissance des plantes. Les engrais liquides sont fabriqués à partir de fumier animal, de compost ou de matières végétales vertes riches en azote, comme la tithonia et les élagages d’arbres agroforestiers.
Troisième étape
Troisième pas : En cas d’épuisement important des éléments nutritifs, de conditions de croissance défavorables ou de carences spécifiques en éléments nutritifs, les agriculteurs biologiques appliquent les mesures supplémentaires nécessaires pour accélérer l’amélioration des conditions de croissance des plantes, comme par exemple :
- En utilisant des engrais organiques commerciaux qui ne contiennent pas de résidus chimiques, s’ils sont accessibles et abordables, les résidus organiques tels que les tourteaux d’huile de graines, le fumier de poulet en granulés, les sous-produits de brasserie, les pelures de fruits, les coques de café et les cendres de plantes peuvent être appliqués au sol tandis que les copeaux de bois et la poussière, les coques de riz, etc. peuvent être mélangés avec d’autres matériaux pour la production de compost.
- Des amendements de sol tels que la chaux sont utilisés pour corriger le faible pH du sol. Les engrais microbiens tels que le rhizobia, et potentiellement aussi les champignons mycorhiziens, peuvent favoriser la fixation de l’azote dans le sol et la minéralisation des nutriments et ainsi améliorer la disponibilité en nutriments des cultures.
- L’application de micro-éléments ou d’oligo-éléments tels que le magnésium, le bore et le manganèse peut être importante, en particulier sur des sols plus légers qui peuvent ne pas fournir suffisamment de ces éléments.
- Dernier point mais non des moindres : l’eau. Sans eau, les plantes ne poussent pas. L’insuffisance de l’approvisionnement en eau limite la minéralisation et le transport des éléments nutritifs dans le sol et du sol à la plante, ce qui nuit à la croissance de la plante et au développement du rendement. De l’autre côté, une trop grande quantité d’eau favorise la perte de nutriments par lessivage et peut aussi causer la pourriture des racines. Dans des conditions sèches, l’utilisation appropriée de l’irrigation pour compléter les besoins en eau du sol peut être essentielle pour obtenir de bons rendements.
Discussion sur la fertilité des sols
Discutez avec les agriculteurs de la fertilité des sols en leur posant les questions suivantes :
Quelle est votre compréhension de la fertilité des sols ? Le concept de nourrir le sol avec des "aliments biologiques" est-il compréhensible pour vous ?
Quelles observations avez-vous faites en ce qui concerne la fertilité des sols et la gestion de la fertilité des sols ? Quand les cultures poussent-elles bien, et dans quelles situations avez-vous observé une mauvaise croissance des plantes ? Comment considérez-vous la pratique du brûlis sur la fertilité du sol à long terme ?
Comment l'approche en trois étapes pourrait-elle être appliquée dans votre exploitation ? Quels pourraient être les défis potentiels à la mise en œuvre de l'approche en trois étapes sur votre ferme ?
Notez les réponses sur un tableau. Ensuite, présentez aux agriculteurs les caractéristiques pertinentes de la fertilité des sols, notamment les fonctions de la matière organique du sol et l'activité biologique. Présentez en détail l'approche de l'agriculture biologique en matière de gestion de la fertilité des sols.
Que sont les engrais verts ?
- Les engrais verts sont des plantes cultivées dans le but premier d’incorporer leur biomasse dans le sol pour fournir des “ nutriments organiques “ et ainsi améliorer sa teneur en nutriments et sa fertilité. Les cultures de couverture et les engrais verts sont presque synonymes. Alors que l’objectif principal des cultures de couverture est de couvrir le sol d’une faible couverture végétale pour le protéger du soleil et de la pluie ainsi que pour étouffer les mauvaises herbes, les engrais verts sont cultivés dans le but principal de produire un maximum de biomasse. La plupart du temps, les légumineuses sont utilisées pour l’engrais vert, car elles peuvent recueillir des quantités considérables d’azote de l’air et le fixer dans leurs racines en plus de fournir de la nourriture pour les organismes du sol. Alors que les légumineuses à graines sont cultivées pour la récolte des graines, les engrais verts sont idéalement récoltés lorsqu’ils sont encore verts et qu’ils ont produit un maximum de biomasse.
- Les engrais verts sont un engrais cultivé à la ferme et, par conséquent, une alternative bon marché aux engrais achetés. Ils complètent bien le fumier animal et sont d’une grande valeur dans les fermes où le fumier animal est rare. Les engrais verts peuvent inciter à abandonner les pratiques traditionnelles nuisibles, comme le brûlage des résidus de culture.
Avantages et potentiels des engrais verts
Par rapport au compostage, une autre méthode généralement recommandée en agriculture biologique, les engrais verts présentent certains avantages :
- Les engrais verts peuvent produire plus de 40 tonnes de biomasse végétale par hectare. Ils apportent de grandes quantités d’azote dans le cycle de production et mettent d’autres éléments nutritifs à la disposition des cultures suivantes. Le compostage, en revanche, consiste à recycler les matières végétales et animales (déchets) disponibles et à fabriquer un engrais de grande valeur avec beaucoup de phosphore et d’autres nutriments, mais avec peu d’azote.
- Les engrais verts protègent le sol de l’érosion par le vent et l’eau, préservant ainsi l’humidité du sol et la matière organique du sol. Ils contribuent ainsi de manière décisive à la conservation des sols.
- Certains engrais verts inhibent efficacement les mauvaises herbes.
- Le semis et, si nécessaire, le fauchage d’engrais verts nécessite de la main-d’œuvre, mais permet d’économiser sur les coûts des engrais et de la main-d’œuvre pour le désherbage.
- Les engrais verts ne nécessitent pas de capital ou d’intrants, si des semences sont disponibles.
- Les engrais verts, en général, n’ont pas besoin d’être irrigués. Ils profitent de l’eau de pluie disponible ou de l’humidité résiduelle du sol.
- Les engrais verts n’ont pas besoin d’être transportés, car ils poussent là où ils sont utilisés.
- Certains engrais verts ont des parties comestibles végétales, d’autres sont des aliments pour animaux de grande valeur.
L’utilisation la plus évidente des engrais verts dans les systèmes de culture communs des producteurs de pommes de terre au Cameroun serait d’utiliser les engrais verts au lieu de la jachère traditionnelle. La valeur fertilisante plus élevée des engrais verts légumineux peut permettre de raccourcir la période de jachère, car la restauration de la fertilité du sol est accélérée. Alternativement, les engrais verts peuvent être semés parmi les cultures en ligne traditionnelles ou peuvent être intercalés vers le moment de la récolte de la culture principale. La concurrence aux cultures alimentaires est réduite si les engrais verts poussent principalement pendant la saison sèche. Alternativement, les engrais verts comme le haricot sabre ou le pois mascate peuvent être cultivés dans les allées. L’évaluation des systèmes de culture traditionnels en Afrique a montré que la rotation des légumineuses avec d’autres cultures est plus productive que les cultures associées.
Les légumineuses ne contribuent pas de façon significative à l’augmentation de la teneur en azote du sol lorsque leurs graines et résidus sont éliminés pour l’alimentation humaine et / ou animale. Si la biomasse ou les résidus de légumineuses sont brûlés ou complètement éliminés des champs, des bilans nutritifs négatifs sont obtenus. Il est donc important de s’assurer que la totalité ou au moins une partie des résidus des légumineuses sont conservés dans le champ, si l’on veut maintenir la teneur en matière organique du sol.
Si les engrais verts sont laissés comme paillis à la surface du sol, ils contribuent efficacement à l’érosion et à la lutte contre les mauvaises herbes et retiennent l’humidité dans le sol. Cependant, les nutriments provenant des paillis ne sont disponibles que lentement. Si les engrais verts sont incorporés dans le sol, une part importante des nutriments est minéralisée en une saison. Ainsi, l’effet fertilisant sur la culture suivante est plus important après l’incorporation. À la fin, la quantité totale d’éléments nutritifs mis à la disposition des plantes est à peu près la même, que les résidus d’engrais verts soient laissés sous forme de paillis ou incorporés.
La couverture végétale dense d’engrais verts protège non seulement le sol de l’érosion par le vent et l’eau, mais empêche également la propagation des mauvaises herbes, ce qui permet de gagner du temps pour la lutte contre les mauvaises herbes. Si les engrais verts laissent un paillis sec et épais, ils peuvent fournir des conditions favorables à la plantation de la culture suivante sans qu’il soit nécessaire de désherber ou de préparer le sol. Certaines espèces d’engrais verts fournissent de généreuses quantités de fourrage à haute teneur en protéines pour le bétail. Cela peut encourager la coopération entre les éleveurs et les agriculteurs de production végétale : les aliments pour animaux peuvent être produits sur certaines parties des terres agricoles en échange de fumier. Mais malgré tous les avantages, les engrais verts peuvent, en tant que seule mesure de gestion de la fertilité des sols, ne suffire pas à maintenir ou même à améliorer la fertilité des sols.
Les espèces d’engrais verts de légumineuses dépendent de la disponibilité d’une quantité suffisante de phosphore, de la présence du bon rhizobium pour la fixation de l’azote, de semences saines et d’une humidité du sol suffisante.
Pour des informations plus détaillées sur la gestion des engrais verts, veuillez consulter la section sur les engrais verts dans le Manuel africain de formation, Module 2, disponible à l’adresse www.organic-africa.net.
Intégration des engrais verts dans les systèmes agricoles
L’une des raisons pour lesquelles les agriculteurs ne cultivent pas d’engrais verts est qu’ils ne savent pas quelles espèces planter et comment les intégrer dans leur système de culture. Il est important de savoir où, quand et comment planter quelles espèces afin d’obtenir des résultats satisfaisants. D’autres obstacles sont liés à la disponibilité immédiate de semences pour les cultures d’engrais verts, à l’intensité de main-d’œuvre et au rendement peu fiable des engrais verts.
Il existe plusieurs façons d’intégrer les engrais verts dans le système agricole :
i. Les légumineuses sont cultivées sous forme de jachère rotative améliorée de court terme.
ii. Les engrais verts de longue durée sont cultivés pendant plus d’une saison.
iii. Les légumineuses alimentaires et non alimentaires peuvent être inter-cultivées avec des cultures régulières.
iv. Les légumineuses non alimentaires de courte durée peuvent être cultivées vers la fin de la saison de croissance des céréales en utilisant l’humidité résiduelle (culture relais).
v. Ou encore, les légumineuses sont cultivées dans un système agroforestier pour fournir une biomasse riche en nutriments.
- Avant de planter à grande échelle, il est conseillé aux agriculteurs d’essayer, sur des parcelles plus petites, les différents types de plantes d’engrais verts et d’observer comment elles poussent dans les conditions locales, et qu’ils s’entraînent à les gérer. La sélection d’engrais verts appropriés est essentielle pour maximiser leur potentiel et minimiser les inconvénients possibles. Les engrais verts doivent convenir au climat, au sol et à la situation locale en matière de ravageurs et de maladies, et s’intégrer dans le système de culture. Les engrais verts annuels doivent avoir une croissance rapide, une croissance vigoureuse et être non ligneux. Ils devraient bien pousser dans les sols les plus pauvres et n’ont pas besoin d’engrais, ni d’irrigation, ni de pesticides, et ils ne devraient pas être étroitement liés à la culture entrante pour éviter la promotion des ravageurs et des maladies qui peuvent affecter la culture suivante.
- Pour maintenir la productivité des terres agricoles, les engrais verts doivent produire au moins 25 tonnes de matière organique fraîche par hectare et par an. Dans des conditions favorables, les espèces d’engrais verts communs peuvent produire jusqu’à deux fois plus de biomasse et recueillir au moins 80 kg d’azote par hectare et par an. Cependant, les non-legumineuses peuvent également être cultivées, à condition qu’elles produisent suffisamment de biomasse et qu’elles développent un bon système racinaire. Les non-légumineuses peuvent aussi survivre mieux dans certaines conditions, croître plus rapidement et parfois tolérer des conditions climatiques extrêmes ou des sols pauvres. Il est donc toujours utile d’essayer de voir ce qui convient le mieux aux conditions locales.
- L’application la plus évidente des engrais verts dans les systèmes de culture de pommes de terre au Cameroun est le remplacement de la jachère traditionnelle en saison sèche par une jachère améliorée de légumineuses. Si la pomme de terre est cultivée pendant la courte saison des pluies (de mars à juin) et récoltée en juillet, et que la culture est suivie de maïs pendant les longues pluies jusqu’en novembre, un engrais vert légumineux peut être semé après la récolte de maïs en novembre, ou peut être interplanté relais dans le maïs en septembre ou en octobre et rester dans le champ pendant toute la saison sèche.
- Jusqu’à présent, peu d’expérience a été faite en matière d’intégration des engrais verts ou de cultures de couverture avec des légumes à croissance lente comme la pomme de terre. Des essais ont été réalisés avec Vicia cultivé en intercalaire avec des choux. Dans les champs irrigués de légumes et de pommes de terre, le fumier ou le compost animal peut être économiquement plus avantageux parce que les terres irriguées sont trop précieuses pour la culture d’engrais verts.
Discussion sur les options d'intégration des engrais verts dans les systèmes agricoles existants
Après la présentation des différentes options d'intégration des engrais verts dans le système agricole, demandez aux agriculteurs quelles sont les options qui leur semblent les plus adaptées à leur situation. Quels avantages attendent-ils de l'engrais vert ? Quelles exigences les engrais verts devraient-ils satisfaire en ce qui concerne les conditions de croissance, la durée de culture, les utilisations comme aliments pour animaux ou pour la consommation humaine ? Quels sont les défis potentiels qu'ils sont susceptibles de rencontrer en intégrant les engrais verts, et comment pensent-ils que ces défis peuvent être résolus ?
Quelques engrais verts potentiels pour les producteurs de pommes de terre:
Niébé / Dolique
Le niébé (Vigna unguiculata) est une légumineuse herbacée originaire d’Afrique de l’Ouest, rampant, grimpant ou arbustif, selon le type. C’est l’une des plus importantes légumineuses tropicales à double usage. Il est largement utilisé comme légume (feuilles et fleurs) ou comme grain pour la consommation humaine, et il constitue un excellent fourrage frais, ensilage ou foin (idéalement en combinaison avec une culture de céréales / graminées). Sa croissance rapide en fait une plante efficace pour contrôler l’érosion.
Le niébé a un fort potentiel fertilisant en fixant environ 80 kg N par hectare (par rapport aux espèces de haricots Phaseolus qui ne fixent qu’environ 30 kg N / ha). La légumineuse peut doubler le rendement d’une culture de maïs suivante par rapport à l’absence de fertilisation et produit des rendements plus élevés qu’une quantité comparable d’azote fournie au maïs avec de l’engrais N inorganique.
Le niébé pousse dans une large gamme de sols, y compris des sols très acides avec un pH de 4 et des sols à faible fertilité, avec une préférence pour des sols plus légers qui permettent un bon enracinement. Le niébé est mieux adapté aux sols fortement acides que le haricot Lablab ou le pois mascate. Cependant, la légumineuse ne tolère pas les inondations prolongées ou la salinité. Il pousse le mieux à 25 à 35 °C et est très sensible au gel. Le niébé est modérément tolérant à la sécheresse.
Selon la variété, la floraison peut commencer aussi tôt que 30 jours après le semis et les graines peuvent être prêtes pour la récolte à 55 jours, ou il peut prendre plus de 90 jours pour fleurir, et 210 à 240 jours pour arriver à maturité. Tandis que les types de buissons déterminés sont meilleurs pour la récolte à la machine, les types indéterminés fourniront des feuilles et des fleurs fraîches sur une longue période de temps pour le ménage.
Si le niébé est nouveau dans un champ, les graines doivent être poudrées avec du rhizobia, une bactérie fixant l’azote, pour permettre à la légumineuse de fixer l’azote de l’air. Les graines sont traitées avec des bactéries achetées ou avec de la terre provenant d’un champ où le niébé a été cultivé. La légumineuse est soit semée à la volée avec jusqu’à 90 kg de graines par hectare, soit semée avec 30 à 60 cm entre les rangs et 10 à 15 cm entre les plantes avec 20 à 50 kg par hectare et une profondeur de semis de 3 à 5 cm.
Le niébé est sensible à de nombreuses maladies et ravageurs, y compris les maladies post-récolte qui attaquent les grains. Il est également l’hôte des ravageurs des haricots Phaseolus et est sensible aux nématodes à galles, qui prospèrent dans les mêmes sols où l’on cultive le niébé.
Le niébé est largement cultivé comme interculturel dans les céréales comme le maïs, soit en tant que type grimpant nécessitant des plantes compagnes fortes, soit en tant que type buisson. Lorsqu’ils sont plantés en même temps que le maïs dans la rangée de maïs, ils économisent de la main d’œuvre pour le désherbage du maïs.
Alternativement, le niébé à cycle court peut être cultivé pendant la saison sèche, protégeant ainsi le sol de la chaleur. Ils mourront et pourront ensuite être incorporés dans le sol avant de semer la prochaine culture.
Tithonia, tournesol mexicain, tournesol sauvage ou fleur des jaloux (Tithonia diversifolia)
La tithonia, un arbuste parent du tournesol et originaire d’Amérique centrale, mais que l’on trouve aujourd’hui dans tous les tropiques, est souvent considérée comme une mauvaise herbe. Cependant, il peut être utilisé pour le fourrage des animaux, le compost, le bois de chauffage, la lutte contre les insectes ou pour améliorer la fertilité du sol. Il a été constaté que la tithonia augmente les rendements du maïs jusqu’à 80 %. Les éléments nutritifs sont surtout concentrés dans les feuilles et les tiges vertes tendres. Les feuilles vertes contiennent jusqu’à 6 % d’azote et 0,5 % de phosphore, ce qui est comparable au haricot velouté. Une fois travaillés dans le sol, ces éléments nutritifs deviennent rapidement disponibles pour la culture suivante.
Tithonia ne fixe pas l’azote comme le font les légumineuses. L’espèce fabrique des tiges ligneuses. Pour l’utilisation comme engrais vert, les feuilles et les tiges sont coupées dans un jeune stade de croissance, hachées et transportées dans les champs, où elles sont utilisées comme paillis ou travaillées dans le sol. En raison de la quantité de travail nécessaire à la «récolte» de la tithonia, l’utilisation de la tithonia comme source de nutriments est plus rentable pour les cultures à forte valeur ajoutée comme les légumes que pour le maïs à valeur relativement faible. Le transfert de la biomasse de la tithonia dans les champs constitue la redistribution des éléments nutritifs au sein de l’exploitation, ce qui nécessite l’apport d’éléments nutritifs aux endroits où la tithonia est cultivée pour soutenir la production.
La Tithonia est principalement cultivée en haies le long des routes, le long des limites des fermes ou sur les courbes de niveau. Une fois mélangé au sol, le matériel végétal frais est réparti sur les billons semi-fabriqués à raison de 2 kg par m2 deux semaines avant le semis d’une culture, puis recouvert de 5 à 10 cm de sol pour finir les billons.
Lorsqu’il est appliqué sous forme de paillis, le matériel est épandu sous la culture 6 à 8 semaines après l’ensemencement de la culture. Couvrir le paillis d’un peu de terre facilite la libération des éléments nutritifs. Le paillage et l’engrais vert peuvent être combinés, ce qui fournira plus d’éléments nutritifs. L’interplantation de Tithonia dans le champ n’est pas recommandée car elle concurrencerait les cultures pour les éléments nutritifs.
La tithonie pousse sur la plupart des sols jusqu’à une taille de 1,5 m à 4,0 m de hauteur et de largeur si elle n’est pas coupée. Pour éviter que Tithonia ne devienne une mauvaise herbe, les haies de Tithonia doivent être coupées régulièrement. La Tithonia peut être récoltée aussi souvent que tous les quatre mois. La Tithonia se reproduit à partir de boutures de tiges et de racines, ainsi qu’à travers de nombreuses petites graines suffisamment légères pour être dispersées par le vent.
Chanvre Sunn (Crotalaria juncea)
Le chanvre Sunn peut contribuer de manière significative en tant qu’engrais organique dans la production de pommes de terre. La légumineuse annuelle, érigée, à forte croissance, non-crimpante, est mieux cultivée en rotation. Cependant, il peut aussi être inter-cultivé dans des légumes comme les choux frisés en le coupant régulièrement. Il pousse jusqu’à des altitudes de 2000 m et a une certaine résistance à la sécheresse. Il n’est pas nécessaire d’innoculer les graines de Crotalaria avec du rhizobia. L’engrais vert est semé par épandage. Les plantes produisent rapidement une couverture végétale épaisse. Pour l’engrais vert, les plantes sont idéalement taillées et travaillées dans le sol environ 60 jours après la plantation, au stade du bourgeon ou du début de la floraison, lorsqu’elles atteignent environ 1 m de hauteur. Pour la production de graines, les plantes nécessitent environ 5 mois avec suffisamment d’eau jusqu’à la floraison suivie d’un temps sec pour le développement des graines. Le matériel végétal peut être utilisé comme aliment pour animaux et les haricots sont comestibles.
Crotolaria peut être cultivé comme jachère à court terme avant le maïs ou après le maïs pendant la saison sèche.
L’association des espèces d’engrais verts en général et de Crotalaria grahamiana en particulier avec la pomme de terre en tant que composante de la culture a été avantageuse dans les essais de recherche au Cameroun. Des résultats similaires avec d’autres espèces d’engrais verts ont été trouvés.
Le semis en relais de Crotalaria dans les pommes de terre âgées d’un mois peut ne pas être recommandé, car l’engrais vert peut ne pas bien se développer dans la culture dense de pommes de terre.
Si le chanvre Sunn est laissé jusqu’à la fin de son cycle et que les graines sont mûres, les capsules doivent être récoltées pour éviter que les graines mûres germent par la suite et deviennent des mauvaises herbes.
Pois mascate (Mucuna pruriens)
Le pois mascate est probablement la culture d’engrais vert la plus répandue dans les tropiques. L’espèce préfère un environnement humide avec jusqu’à 2500 mm de pluie, mais elle pousse aussi dans des zones plus sèches. Il résiste à la sécheresse, mais mourra pendant la saison sèche. Dans les climats frais, il poussera 3 à 4 mois après le début de la saison sèche.
Le type Mucuna typique est crimpant, mais il existe aussi un type buisson ou nain (Mucuna enana). Le deux formes produisent une canopée dense et inhibent bien les mauvaises herbes. Les graines ne sont pas comestibles en raison de L-dopa et doivent être bouillies bien avant d’être consommées. Les feuilles de Mucuna peuvent être mélangées avec 4 fois d’herbe de Napier pour le fourrage, et les résidus peuvent être utilisés comme fourrage, ensilage ou foin.
Le type buisson fleurit en 80 à 90 jours, alors que la plupart des pois mascate peuvent prendre jusqu’à un an pour produire des graines. Le pois mascate buisson pousse mieux à des températures de 20 à 30 °C et à des altitudes de 2000 m. Il est sensible au gel et très résistant aux insectes. Il peut fixer jusqu’à 200 kg / ha d’azote et produire environ 4 tonnes/ha de matière sèche dans les sols fertiles. Il contribue également à la lutte contre les nématodes.
Le pois mascate peut être planté au début de la saison des pluies comme jachère améliorée sur des sols sévèrement dégradés. Il peut également être semé en relais dans les cultures céréalières avec taille répétée et utilisé par la suite comme jachère améliorée. La culture suivante est ensuite semée dans le paillis de mucuna mort.
Le type nain peut également être associé à des cultures annuelles.
Haricot Lablab (Lablab purpureus)
Lablab (Lablab purpureus) est une légumineuse grimpante à croissance rapide. Des variétés nain sont également disponibles. Le haricot Lablab a une grande tolérance à la sécheresse lorsqu’il est établi et peut rester vert tout au long de la saison sèche. Son cycle long permet de couvrir le sol pendant une période prolongée s’il n’y a pas de gèles dûres, ce qui lui permet de se développer comme une plante bisannuelle. Les haricots Lablab poussent bien jusqu’à environ 1 500 mètres. Il nécessite des sols plus fertiles que le haricot sabre. Lablab commence à fleurir après 3 mois et continue à produire des graines ainsi que de la verdure. Contrairement au pois mascate ou au haricot sabre, le haricot Lablab peut être coupé près du sol et repoussera avec une vigueur réduite. Comme les animaux aiment beaucoup le lablab, cet engrais vert ne peuvent pas être cultivés là où les animaux sont libres. D’autre part, les haricots Lablab peuvent servir comme pâturage de haute valeur pour les animaux pendant la saison sèche. Les jeunes capsules de Lablab et les graines immatures et secs peuvent être consommés.
Haricot sabre (Canavalia ensiformis)
Le haricot sabre (Canavalia ensiformis) résiste à la sécheresse, aux sols pauvres, aux insectes et aux maladies. Il existe un type grimpant et un type nain. L’espèce croîtra 5 à 6 mois pendant la saison sèche et peut protéger le sol pendant cette période en prévenant l’érosion. L’espèce est très utile pour régénérer les terres abandonnées ou comme engrais vert après la récolte d’une culture tardive dans la saison des pluies. Le haricot sabre pousse jusqu’à environ 1 800 mètres. Les plantes commencent à fleurir après 4 à 5 mois, puis produisent continuellement des capsules pendant au moins une année entière.
Le haricot sabre peut être semé dans les céréales, sous les vergers ou pour raccourcir les périodes de jachère. Comme il n’est pas aussi vigoureux que le pois mascate, les mélanges des deux espèces peuvent donner les meilleurs résultats.
Pois d’Angole (Cajanus cajan)
Le pois cajan est originaire de l’Inde, mais il est largement répandu en Afrique orientale et centrale. Il a un port arbustif et est habituellement vivace, mais de nouvelles variétés ont été développées, qui produisent des graines en 3 à 4 mois. La plante peut être utilisée pour la consommation humaine ainsi que comme fourrage pour les animaux, comme engrais vert ou comme culture de couverture. Pour la consommation humaine, les pois d’Angole sont consommés frais ou séchés et cuits, moulus ou germés.
La fixation de l’azote dans les pois d’Angole est d’environ 90 kg par hectare et an. La plante pousse bien sous des conditions sèches. 650 mm de pluie par an suffisent à la croissance de la culture. La culture intercalaire avec le maïs ou le riz est très répandue en Amérique et en Asie. La plante est également connue au Cameroun et pourrait être utilisée dans la rotation des cultures comme culture de rente en ajoutant des nutriments au sol.
Haricot empoisonné (Tephrosia vogelii)
Le haricot empoisonné a un aspect arbustif, atteint jusqu’à 4 m de hauteur et est vivace. Elle est très adaptative, tolère différents climats, des sols pauvres, des sécheresses et des vents forts. Cependant, la plante a besoin de 850 mm de précipitations annuelles. Le haricot empoisonné produit ses premières graines après 3 mois. Comme la plante est une légumineuse, elle fixe l’azote dans ses nodules. Le haricot empoisonné est utilisé depuis des décennies comme jachère améliorée dans certaines zones du District du Nord-Est du Cameroun. Comme son nom l’indique, il est toxique pour les poissons, si l’extrait entre en contact avec l’eau. Ses feuilles sont toxiques pour le bétail. Par conséquent, le bétail ne le mangera pas. L’extrait de haricot empoisonné est utilisé comme acaricide sur le bétail. Certains effets contre les insectes nuisibles ont été signalés, mais n’ont pas encore fait l’objet d’essais scientifiques.
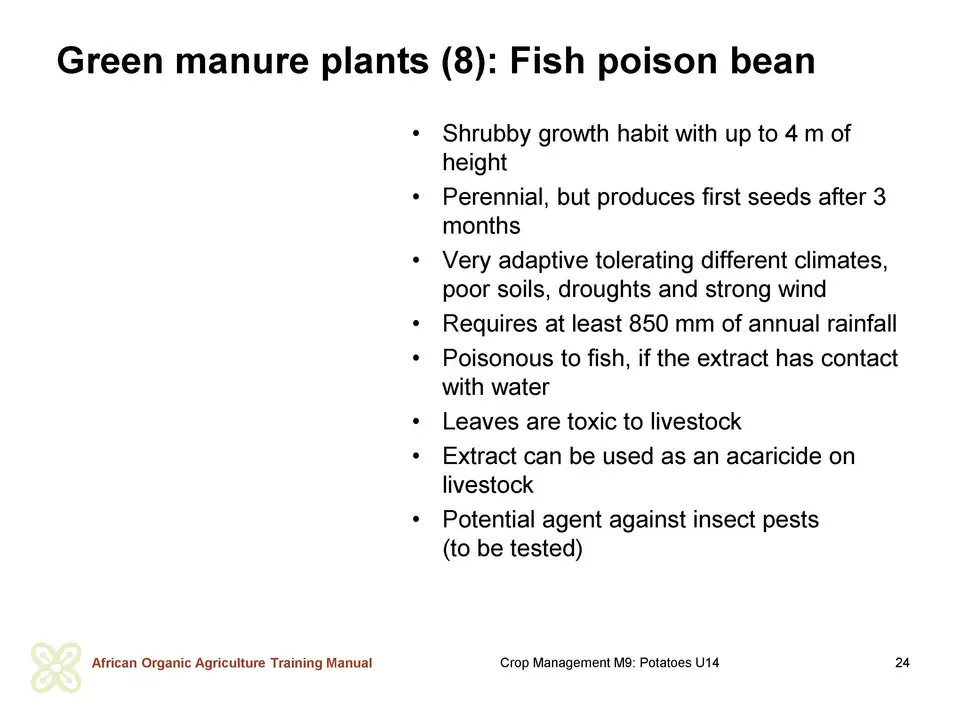
Compost
Le compost est un engrais organique de grande valeur, en particulier dans les conditions tropicales, car il contribue de la matière organique stable et aide à construire le sol à long terme. Le compost est un nom commun utilisé pour les matières organiques décomposées. Par rapport à la décomposition incontrôlée, telle qu’elle se produit naturellement, la décomposition dans le processus de compostage contrôlé est plus rapide, atteint des températures plus élevées et donne un produit de meilleure qualité. Les nutriments fournis par le compost sont plus équilibrés du point de vue des plantes que le fumier animal. Le compost améliore la structure du sol et augmente sa capacité de rétention d’eau. Il peut également supprimer les maladies du sol dans certains cas.
La fabrication du compost repose sur des matériaux disponibles à la ferme et ne nécessite aucun équipement spécial (à l’exception peut-être d’un déchiqueteur et d’un arrosoir ou d’une sorte d’irrigation, si le compostage se fait à grande échelle), ce qui en fait une méthode bon marché. D’autre part, la production de compost exige beaucoup de travail pour la récolte et la préparation des matières, puis pour retourner le tas de compost régulièrement pendant la période de compostage. Par conséquent, la production de compost peut être économique principalement dans les systèmes de culture avec des cultures de grande valeur comme les légumes et les pommes de terre.
Idéalement, le compost est fait de quantités égales de fumier animal et de matières végétales fraîches et de matières ligneuses sèches. Le matériel végétal de ferme comprend les résidus de cultures, les mauvaises herbes ou les plantes cultivées spécifiquement pour leur biomasse. On peut aussi ajouter des cendres de bois et du vieux compost. La production de compost nécessite des conditions humides. Par conséquent, un arrosage régulier est nécessaire par temps sec pour assurer une décomposition correcte.
Pour des informations détaillées sur les avantages du compost et la procédure de production de compost, veuillez consulter la section sur le compost du Manuel africain de formation, Module 2, disponible sur www.organic-africa.net.
Évaluation du compost comme engrais et amendement du sol
Discutez avec les agriculteurs les avantages et les contraintes de la production de compost dans les circonstances locales par rapport à l’engrais vert et à d’autres mesures pour améliorer la nutrition des plantes et la fertilité des sols. Quelles sont les matières premières disponibles à la ferme ? Y a-t-il suffisamment de main-d’œuvre disponible pour la production de compost ? Comment peut-il être transporté dans les champs ? Comment les avantages doivent-ils être considérés par rapport aux inconvénients ?
Rotation des cultures
L’approche de l’agriculture biologique en matière de gestion de la fertilité des sols et de la nutrition des plantes influence la conception de la rotation des cultures. En agriculture biologique les cultures sont organisées de manière à contribuer le mieux possible à la fertilisation de la culture suivante, au maintien de la fertilité du sol et à la lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes transmis par le sol.
Regroupement des cultures en fonction des besoins en nutriments
Les cultures peuvent être regroupées en fonction de leur demande en azote (ou en éléments nutritifs), en distinguant les cultures à forte consommation et à consommation modérée et les cultures fertilisantes. Les cultures à forte consommation comprennent telles que le maïs, le chou ou le poireau. Ces cultures dépendent de quantités élevées d’azote pour produire de bons rendements. Les cultures à consommation modérée comprennent les cultures de racines et de tubercules, ainsi que les fruits et les légumes-feuilles. Les cultures fertilisantes comprennent les légumineuses comme les haricots, les pois et les engrais verts (légumineux) qui sont cultivés principalement pour améliorer la fertilité du sol.
L’azote fourni par les cultures fertilisantes est mieux exploité si une légumineuse est suivie d’une culture à forte consommation. Les cultures à forte consommation devraient être suivies d’une culture à consommation modérée. Après les cultures à forte consommation comme le maïs ou les choux, il ne reste que peu d’éléments nutritifs dans le sol. Pour cultiver deux cultures à forte consommation l’une après l’autre, il faut un apport élevé en nutriments et en engrais.
Les agriculteurs biologiques cultivent des engrais verts ou des légumineuses en rotation pour rétablir le niveau d’azote dans le sol. Les engrais verts légumineux cultivés pour l’amélioration des sols laissent plus d’azote dans le sol que les légumineuses, dont les grains sont récoltés. Les jachères traditionnelles d’une ou deux années composées de plantes spontanées (dont la plupart sont des mauvaises herbes) sont idéalement remplacées par une jachère intensive (ou améliorée) pour restaurer le niveau d’azote du sol. L’introduction d’une jachère améliorée permettra en outre de raccourcir la période de jachère, ce qui entraînera une intensification du système de culture.
Comme alternative aux cultures d’engrais verts, les cultures fourragères herbacées fixatrices d’azote peuvent être cultivées en rotation. Les aliments produits peuvent être offerts aux éleveurs pour le pâturage en échange du fumier. Le défi peut cependant être de s’assurer que le fumier animal reste dans le champ et n’est pas déposé à l’extérieur du champ.
Regroupement des cultures en fonction de leur sensibilité aux maladies et aux ravageurs.
La conception de la rotation des cultures joue non seulement un rôle clé pour la gestion de la fertilité des sols, mais elle est également importante pour la lutte contre les ravageurs du sol et les maladies telles que les nématodes. Pour cette raison, les cultures de différentes familles de plantes botaniques devraient faire l’objet d’une rotation. Pour prévenir l’accumulation de ravageurs et de maladies du sol, la plupart des cultures, y compris la pomme de terre, ne devraient pas être cultivées sur le même champ plus d’une fois tous les trois ou quatre saisons. Tant qu’aucun ravageur ou maladie du sol n’est observé, les pommes de terre peuvent être cultivées toutes les trois saisons dans le même champ. Pendant la pause de culture, d’autres cultures de la famille des solanacées parent de la pomme de terre comme la tomate, le poivron, l’aubergine et d’autres ne devraient pas être cultivées dans ce champ. De plus, les plants de pommes de terre qui se développent spontanément doivent être arrachés. Par conséquent, pas plus d’un tiers ou d’un quart des terres agricoles devrait être cultivé avec des pommes de terre ou d’autres solanacées à la fois. La même règle s’applique en cas de culture mixte de pommes de terre avec d’autres cultures
Exercice : Concevoir des rotations appropriées
Demandez aux agriculteurs quelles sont les cultures qu’ils cultivent actuellement. Notez chaque culture, y compris les pommes de terre, sur une carte.
Si les agriculteurs ont déjà cultivé des pommes de terre, demandez-leur de décrire la rotation qu’ils pratiquent sur leur ferme. Quelles expériences ont-ils faites avec leur rotation en ce qui concerne la fertilité des sols et les maladies transmises par le sol ? Discutez des rotations dans le groupe. Mentionnez les aspects critiques et faites des suggestions de changements possibles en accordant une attention particulière à la production de pommes de terre.
Cultures précédentes et suivantes à la pomme de terre
La culture de pommes de terre a une demande relativement élevée en azote au cours de la première moitié de sa période de croissance. Par conséquent, elle se développe particulièrement bien après les cultures qui laissent un sol meuble et une grande quantité de matière organique facilement dégradable. Ainsi, les légumineuses à grains telles que les haricots et autres légumes font partie des cultures précédentes appropriées. Les engrais verts légumineux ou les cultures fourragères sont également une option. Les choux comme le brocoli, le chou et la moutarde qui précèdent la culture de pommes de terre réduisent le flétrissement bactérien et les nématodes à galles dans le sol. Lors de la récolte de la culture précédente ou du paillage de l’engrais vert, il faut veiller à ne pas compacter le sol.
Après la culture de pommes de terre, de grandes quantités d’azote soluble restent dans le sol. Pour éviter le lessivage des nutriments en cas de pluie ou d’érosion par le vent si la culture est suivie d’une période de sécheresse, il convient de cultiver rapidement soit une culture successive avec une demande élevée en azote comme le maïs, les choux, les poireaux ou une céréale, soit une culture fourragère. Alternativement, le sol est recouvert d’une culture de couverture pour capter l’azote et prévenir l’érosion.
La culture de pommes de terre laisse généralement un champ propre pour la culture suivante. Cela permet un travail du sol réduit ou minimal pour la préservation de la structure du sol.
Cultures associées avec pommes de terre
La culture associée est assez répandue au Cameroun. Cette pratique améliore la sécurité alimentaire en minimisant les conséquences de l’échec d’une culture individuelle. Elle fait cela en tirant parti des caractéristiques complémentaires des cultures, en réduisant les risques dus aux ravageurs et aux maladies et en contribuant à la lutte contre l’érosion.
Certains agriculteurs cultivent traditionnellement des cultures associées ou mixtes comme le maïs et les haricots ou la pomme de terre et les haricots, soit en alternance, soit en culture en allées. Au début de la saison des pluies, la pomme de terre est souvent associée au maïs, au cocoya, au chou ou à d’autres cultures annuelles. Les haricots sont un choix courant de culture mixte avec les pommes de terre à la fin de la saison. Les cultures qui ne se prêtent pas à l’association avec la pomme de terre sont le céleri et les solanacées comme les poivrons, les aubergines et les tomates. Généralement, les cultures associées sont plantées au fond ou au bord des sillons et les pommes de terre sur la butte.
Bien que la culture mixte avec une légumineuse de courte saison comme les haricots puisse augmenter le rendement total de la culture et aider à prévenir la propagation des maladies, les pommes de terre sont plutôt cultivées en rotation avec d’autres cultures afin de produire des rendements élevés de pommes de terre, de limiter efficacement les mauvaises herbes et de simplifier la gestion. Les cultures associées cultivées sur la butte doivent être récoltées en même temps que les pommes de terre.
Défis liés à la sélection des variétés
Le choix des variétés dans la production de pommes de terre dépend de l’utilisation prévue, des préférences des consommateurs, du rendement potentiel, de la résistance aux ravageurs et aux maladies, de l’adaptation aux conditions de croissance locales et du matériel de plantation disponible. Bien que l’utilisation prévue, le potentiel de rendement et les préférences des clients jouent un rôle important dans la sélection variétale, de bonnes caractéristiques de croissance d’une variété et la résistance aux maladies ou la tolérance peuvent être des facteurs décisifs. La variété préférée sur le marché peut être très sensible au mildiou et donc difficile à cultiver. L’introduction d’une nouvelle variété résistante peut nécessiter des efforts importants de toute la chaîne de valeur pour convaincre les consommateurs des qualités de la nouvelle variété. Au Cameroun, la disponibilité de plants sains est une question essentielle.
Critères pertinents
Les agriculteurs biologiques recherchent des variétés à croissance rapide, produisant rapidement un couvert végétal pour une bonne suppression des mauvaises herbes, une formation précoce des tubercules pour obtenir de bons rendements avant l’apparition du mildiou, et une faible sensibilité aux maladies ainsi que de faibles besoins en azote. La courte durée de croissance peut être très importante au Cameroun pour éviter les pertes par le mildiou, qui est généralement une menace plus sérieuse pendant les mois de juin à septembre lorsque les pluies sont régulières.
Certaines variétés présentent un risque réduit de la gale commune, de cœur creux, Rhizoctone (dry core), Mildiou, de la maladie des taches argentées et de la jambe noire, etc. Cependant, aucune variété n’est résistante à toutes ces maladies. Par conséquent, les recommandations régionales peuvent être utiles dans la sélection des variétés pour choisir les variétés ayant les meilleures résistances.
Avant de choisir une nouvelle variété ou de produire pour un nouvel acheteur, les coopératives agricoles et les grandes exploitations agricoles doivent discuter des exigences variétales avec le commerce de détail, car il demandera des variétés qui sont demandées le plus par le marché. Les agriculteurs qui produisent pour les marchés locaux ont plus de liberté dans la sélection des variétés et peuvent progressivement introduire de nouvelles variétés ayant des caractéristiques différentes. Idéalement, il est préférable de cultiver les nouvelles variétés à petite échelle au cours de la première année, ce qui permet de les comparer avec les variétés établies.
Critères de sélection variétale :
- Rendement : Les variétés qui produisent de nombreux tubercules de grande taille donnent plus de rendement et sont préférées par les clients (et permettent d’obtenir un prix plus élevé).
- Les variétés tolérantes ou résistantes à des maladies telles que le mildiou et les virus réduisent la dépendance à l’égard des mesures de protection des plantes et limitent le risque de mauvaises récoltes.
- Précocité : Les variétés à croissance rapide avec un cycle de production court de 90 jours peuvent être cultivées dans l’intersaison (courte).
- Préférences du marché : Certains clients ou marchands préfèrent les pommes de terre à peau blanche tandis que d’autres préfèrent les pommes de terre à peau rouge. De plus, la taille des tubercules et la profondeur des yeux peuvent être des critères pertinents.
Discussion of criteria for potato variety selection
Demandez aux agriculteurs quels sont les critères qu'ils prennent en compte dans la sélection des variétés. Mentionnez des critères supplémentaires, si certains n'ont pas été mentionnés. Discutez de la pertinence des différents critères. Évaluer les variétés disponibles et potentielles en fonction des critères sélectionnés. Discuter de l'aspect critique de la disponibilité du matériel de plantation. Comment pourrait-on améliorer la disponibilité du matériel végétal demandé ?
Variétés enregistrées
Plusieurs variétés sont enregistrées au Cameroun. Cipira, Tubira, Bambui wonder, Jacobs 2005, IRAD 2005 et Maffo ont été lancés par le programme national de recherche - Institut de recherche agricole pour le développement IRAD. De nouvelles variétés à haut rendement ont été sélectionnées grâce à la collaboration de l’IRAD du Cameroun et du Centre international de la pomme de terre (CIP). Cette collaboration a conduit à la mise sur le marché de variétés telles que Cipira et Tubira. Les deux variétés sont bien adaptées à la production au Cameroun. Cipira, bien que dégénérée, est encore largement plantée. IRAD a également lancé plusieurs autres variétés par le biais d’évaluations et de tests d’adaptabilité du matériel génétique du CIP.
Les variétés de pommes de terre certifiées ont été soumises à des tests de résistance indépendants pour les principaux ravageurs, maladies et agents pathogènes. Les essais sont effectués dans le cadre du programme d’essais indépendants de variétés (IVT) financé par l’AHDB Potatoes.
Variétés nouvelles introduites
Un bon nombre des variétés établies de longue date ont dégénéré à la suite d’une infection virale au fil des ans ou sont devenues sensibles au mildiou. Ainsi, en 2017, le Centre d’innovation verte a introduit des plants de six nouvelles variétés de pomme de terre au Cameroun. Conformément à la législation nationale, les nouvelles variétés introduites doivent être examinées du point de vue de la distinction, de l’homogénéité, de la stabilité et de la valeur agronomique et technologique. Les nouvelles variétés comprennent Marabel, Jelly, Juwel, Bavapom, Sevim et Kronen. Ces variétés ont une courte période de croissance d’environ 90 jours, un potentiel de rendement élevé et montrent une tolérance ou une résistance aux principales maladies. Jelly est très répandue dans l’agriculture biologique d’Europe centrale, car elle a bon goût et est saine. Kronen et Sevim sont très résistants au mildiou et ont une demande modérée en azote. Kronen a une levée lente et doit donc être bien pré-germée. Ces variétés pourraient être bien adaptées à l’agriculture biologique au Cameroun.
L’importation de plants de pommes de terre d’Europe pour garantir aux agriculteurs des semences de haute qualité a entraîné des pertes importantes pendant le transport et le stockage avant utilisation sur le terrain dans le passé. Cette procédure s’est donc avérée non viable. L’importation de plants de pommes de terre certifiés peut être une première étape temporaire vers l’établissement d’une production nationale de semences de qualité.
La disponibilité des semences doit être abordée dans un contexte large et des solutions doivent être développées au niveau national. La production de variétés adaptées au site doit être soutenue. La propagation, l’adaptation et l’utilisation de variétés génétiquement résistantes (par exemple Carolus) devraient être développées. Une collaboration avec le Centre international de la pomme de terre CIP devrait être envisagée.
Méthodes de production de plants
Certains agriculteurs du nord du Cameroun ont été formés à la production commerciale de plants de pommes de terre. La production de plants à la ferme nécessite des connaissances spécifiques et n’est possible que dans le cadre d’un contrat avec les organisations productrices de semences. Les plants doivent être cultivés à une distance suffisante des champs de pommes de terre ordinaires pour éviter les infections par des virus et le mildiou. La production de pommes de terre de semence à des altitudes plus élevées donne des plants à germination plus lente.
La production de mini-tubercules, telle que pratiquée par la CIP au Kenya, est une alternative valable à la production standard de plants de pommes de terre. Toutefois, les mini-tubercules doivent être multipliées par des spécialistes et sous la supervision du CIP ou d’une organisation nationale équivalente.
Pour accroître la disponibilité de plants de pommes de terre de haute qualité, le Centre international de la pomme de terre (CIP) et ses partenaires ont mis au point la « révolution de la génération de pommes de terre de semence 3 « (3G). L’approche utilise des techniques de multiplication rapide (RMT), comme l’aéroponique ou la culture de sable, pour produire des mini-tubercules à partir de plantules in vitro, et deux générations successives en plein champ pour la multiplication des semences. L’approche implique la recherche agricole nationale et les systèmes de vulgarisation, et comprend des formations des agriculteurs en matière de gestion et de stockage des semences.
Au cours des dernières années, l’idée d’utiliser de vraies semences de pomme de terre pour la production de plants ou de tubercules de consommation a suscité de l’intérêt. Les semences véritables ne transmettent pas la plupart des maladies de la pomme de terre, sont très légères et faciles à transporter. Les vraies semences de pommes de terre (TPS) peuvent être semées directement dans le champ, cultivées comme semis à partir de vraies semences dans une serre ou sur un lit de semis et transplantées plus tard dans le champ au cours de la même saison, ou semées directement dans des lits de semis à distance rapprochée pour la production de tubercules de semis. Des tests pratiques ont montré que la transplantation de plantules donnait significativement plus de tubercules par plant que par semis, mais le rendement des tubercules par hectare et le pourcentage de tubercules de taille standard étaient beaucoup plus faibles. La petite taille du tubercule récolté rend cette méthode de multiplication inappropriée pour la production de pommes de terre de consommation. Cependant, il peut s’agir d’une approche intéressante pour la production de tubercules bébés.
Une autre manière d’améliorer la disponibilité de semences de pommes de terre saines est d’établir une production de semences à la ferme. Cependant, cette méthode de production de plants n’est normalement pas supervisée par des experts et n’aboutit pas à des semences de qualité certifiée (pour plus d’informations, voir ci-dessous).
Qualité et provenance des plants
La qualité des plants est très importante pour le succès de la production de pommes de terre. Le matériel de plantation doit être exempt de maladies qui peuvent être transmises par les semences. L’utilisation de plants certifiés réduit le risque d’infection par les maladies des tubercules. Par conséquent, des plants de pommes de terre certifiés devraient être utilisés si possible. Toutefois, il se peut que ce matériel de plantation ne soit pas disponible ou qu’il soit trop cher. Au lieu de cela, on peut utiliser des semences de haute qualité avec un antécédent connu, par exemple à partir d’un multiplicateur de semences connu.
- Tout matériel de plantation acheté doit être contrôlé pour détecter les défauts de qualité tels que les marques de Rhizoctone brune ou la pourriture humide bactérielle. Les défauts doivent être signalés immédiatement au fournisseur (conserver les étiquettes des semences).
- Fondamentalement, les mêmes critères de qualité s’appliquent pour le matériel de plantation non certifié et conservé que pour les semences certifiées. Dans la pratique, les semences non certifiées présentent un risque plus élevé de transmission de maladies transmises par les semences, comme les virus, que les semences certifiées. Par conséquent, dans le cas d’une sélection de semences dans la ferme, les agriculteurs devraient marquer les plantes saines sur leurs champs de production et vérifier la qualité externe des semences conservées afin de réduire le risque de transmission de maladies à la prochaine culture de pommes de terre.
- Le traitement du matériel de plantation avec des antagonistes tels que Bacillus subtilis et Pseudomonas peut réduire l’infection par Rhizoctonia et le dry core. Cependant, il se peut que ces traitements ne soient pas courants au Cameroun et leur efficacité n’a pas encore été prouvée.
- Le calibrage du matériel de plantation facilite la culture, car les plantes calibrées permettent d’obtenir des plantations plus homogènes.
- Pour la production biologique certifiée de pommes de terre, le matériel de plantation doit provenir de multiplication biologique. Si ces semences ne sont pas disponibles pour certaines variétés, il peut être nécessaire d’obtenir une autorisation exceptionnelle de l’organisme d’inspection avant d’acheter des plants conventionnels.
Multiplication de plants à la ferme
L’utilisation continue des mêmes matériels végétaux année après année sans remplacement périodique encourage l’infestation des tubercules par des maladies qui sont transmises par les semences, en particulier par des virus. L’infestation virale réduit considérablement le potentiel de rendement des plants de pomme de terre.
Une méthode pour obtenir des semences de bonne qualité pour la saison suivante est la technique de la parcelle semencière. Pour leur propre multiplication de plants, les agriculteurs achètent de petites quantités de plants de qualité et les multiplient dans la partie la plus saine de leurs terres. Cette technique permet de répondre en partie à l’important besoin de plants sains.
- Emplacement : Les parcelles de semis doivent être établies sur la partie supérieure de la pente de la ferme. La surface ne devrait pas avoir eu de cultures de solanacées depuis au moins 5 ans. De préférence, la parcelle a été recouverte d’une jachère d’engrais verts ou d’herbe dense ou a été vierge. La parcelle est idéalement située en altitude, à une distance en amont des champs de pommes de terre commerciaux et des cultures hôtes alternatives pour réduire la dissémination des virus par les pucerons porteurs de virus. Le site doit être bien aéré, bien drainé avec plein soleil et ne doit pas avoir reçu de chaux depuis 5 ans.
- Taille : La taille de la parcelle de semis dépend de la zone de production prévue et du taux de multiplication de la variété (nombre moyen de tubercules de semence produits par une plante). La technique des parcelles de semis utilise environ 50 % moins de terre que la production de pommes de terre de consommation pour répondre aux besoins en tubercules de semence à la ferme. Pour 1 hectare de terrain, il faut environ 2.500 kg de tubercules de semence. Avec un poids moyen des tubercules de 50 à 70 g et en fonction des distances de plantation, 25.000 à 50.000 tubercules sont nécessaires pour planter la surface. A un taux de multiplication estimé à 10, au moins 2.500 à 5.000 tubercules doivent être plantés dans la parcelle de semis. Si une partie des tubercules de semence multipliés sera utilisée pour produire plus de semences pour la saison suivante, plus de surface est nécessaire.
- Préparation du lit de semis : La terre est labourée à une profondeur de 20 à 30 cm. Ensuite, le sol est formé sur un lit surélevé de 15 cm de hauteur et de 1,5 m de largeur. La longueur du lit dépend de la taille du terrain.
- Fertilisation : Idéalement, des légumineuses étaient auparavant cultivées sur la parcelle fournissant suffisamment d’azote pour la pomme de terre de semence. Autrement, un engrais organique riche en azote, comme le fumier de poulet et/ou le compost, est répandu sur le lit de semence et est bien mélangé dans le sol. La quantité d’engrais ou de compost épandu sur 1 hectare doit contenir au moins 100 kg d’azote.
- Récolte en bordure : Pour minimiser l’infestation des plants de pommes de terre par les pucerons, au moins 4 rangs de maïs peuvent être plantés 2 à 3 semaines avant les pommes de terre de semence autour de la parcelle de semence comme culture de bordure.
- Une autre mesure de prévention consiste à nettoyer et désinfecter les outils, les pieds et les chaussures avant d’entrer dans la parcelle de semis avec un agent de blanchiment domestique (hypchlorite de sodium) à une concentration de 50 ml dans 1 litre d’eau.
- Espacement : Les tubercules sont plantés à un écart de 30 cm sur 30 cm avec une distance de 15 cm aux bords du lit et à une profondeur de 10 à 15 cm. Pour produire des semences pour 1 hectare, il faut une parcelle de semis d’environ 300 m de long.
- La gestion des cultures est la même que pour une culture régulière de pommes de terre, y compris la lutte contre les maladies et les ravageurs. Cependant, le désherbage et le déchaumage se font à la main en tirant les mauvaises herbes sur les lits et en ajoutant ensuite de la terre des côtés pour élever le lit à une hauteur d’environ 5 à 10 cm à partir de la hauteur initiale. Les mauvaises herbes à fleurs jaunes en particulier doivent être éliminées, car les pucerons sont attirés par la couleur jaune. D’autres plantes-hôtes de ravageurs et de maladies de la pomme de terre à l’intérieur et autour du champ devraient également être éliminées.
- Observation : La parcelle de semence devrait être inspectée chaque semaine pour surveiller le rendement des cultures et en particulier la présence de pucerons, de papillons nocturnes des tubercules de pomme de terre, de flétrissement bactérien, de virus, ainsi que le mildiou. Les jeunes plants de pomme de terre en particulier devraient être protégés contre les attaques des pucerons, car les jeunes plants sont plus sensibles aux attaques virales que les plantes plus âgées, et les plantes infectées tôt deviennent des sources plus efficaces de propagation du virus que les plantes infectées plus tard dans la saison.
- Lutte contre les pucerons : Les pucerons peuvent être contrôlés par un traitement ponctuel avec du Neem, ou avec du savon potassique à une concentration de 2 %. En cas d’une haute pression d’infestation, il est recommandé de traiter avec de la pyréthrine ou de la quassia dans un mélange avec du savon potassique (toujours ajouter du savon potassique en dernier).
- Lutte contre la teigne de la pomme de terre : Pour prévenir l’infestation par la teigne de la pomme de terre, les tubercules doivent être recouverts d’une quantité suffisante de terre en tout temps. Les plantes présentant un flétrissement bactérien et/ou une infection virale doivent être arrachées et détruites. Après avoir enlevé une plante fanée, deux mains pleines de cendres ou une main pleine de chaux doivent être étalées dans le trou. L’application répétée et préventive de cuivre est recommandée contre la Alternariose et le mildiou, où les infections sont fréquentes.
- Moment de la récolte : Lorsque l’essai de fouille montre que les tubercules ont atteint la taille requise (au Cameroun en général 20 à 40 mm de diamètre), les tiges des plantes doivent être coupées. Depuis le moment de défanage à la récolte des tubercules, une période d’environ 2 semaines doit être attendue pour que la peau des tubercules durcisse. Les pousses qui repoussent pendant cette période doivent être enlevées, car les jeunes pousses sont facilement infestées par des pucerons qui propagent des virus.
- Les tubercules doivent être récoltés lorsque le sol est sec afin d’éviter de les blesser. Les tubercules trop grands devraient être vendus comme pommes de terre de consommation.
- Stockage des plants : Les plants sélectionnés doivent être stockés dans une lumière diffuse et avec une aération suffisante, séparés par variétés, et étalés finement sur le sol ou dans des caisses en bois. Les tubercules de pomme de terre de semence devraient être protégés des pucerons pendant l’entreposage afin d’éviter la transmission de virus lors de l’entreposage, car les pucerons de la pomme de terre colonisent facilement les germes de tubercules. Les pommes de terre de semence sont très sensibles à l’infection à ce stade. Les tubercules peuvent également être recouverts de branches de Lantana camara. Le stockage des pommes de terre de semence sous la sciure de bois permet d’éloigner les mites des tubercules et de conserver les plants plus longtemps. Les tubercules de semence devraient être entreposés dans des magasins sombres utilisés pour les pommes de terre de consommation et dans des sacs denses.
- Remplacement des semences : Une partie de la pomme de terre de semence peut être utilisée pour la production de nouveaux tubercules de semence, l’autre partie est utilisée pour la production de pommes de terre de consommation. Les tubercules de semences provenant de semences propres ne doivent pas être multipliés pendant plus de trois saisons afin de prévenir les pertes de qualité dues à l’accumulation de maladies et de ravageurs transmis par les tubercules.
Exercice pratique : Démonstration de la technique de la parcelle de semis
Démontrez le processus pour la préparation d’une parcelle de semis de pommes de terre.
Prégermination
Avant la plantation, les plants de pomme de terre doivent être prégermés. La prégermination augmente considérablement la sécurité du rendement, car les tubercules prégermés émergent plus rapidement et sont prêts à être récoltés 10 à 14 jours plus tôt que les tubercules non prégermés. Cela réduit la probabilité que les germes sensibles soient infectés par le rhizoctone ou la Jambe noire, et réduit le risque d’infection par le mildiou.
De plus, la pré-germination entraîne moins de germes et, par conséquent, moins de tiges par unité de surface foliaire, ce qui réduit le nombre de tubercules, mais augmente leur taille. La charge de travail supplémentaire pour la prégermination est récupérée grâce à des rendements plus élevés et à une plus grande sécurité de rendement.
La température a la plus grande influence sur le nombre de germes ultérieurs dans le processus de prégermination. Les nouvelles variétés de pommes de terre devraient avoir moins de germes afin d’atteindre rapidement la taille requise. Les tubercules destinés à la production de pommes de terre de semence devraient avoir plus de germes pour donner de nombreux tubercules de taille plutôt petite.
Des germes multiples courts et forts sont extrêmement importants pour un rendement élevé. De plus, les tubercules de semence à germes courts et fermes peuvent être transportés au champ avec moins de risques de dommages causés aux germes que les tubercules à germes longs.
Le développement des germes est principalement affecté par l’intensité de la lumière. Si les tubercules sont bien exposés à la lumière diffuse (mais si possible pas à la lumière directe du soleil), les germes seront lents en croissance, colorés et robustes. Les tubercules de semence conservés dans l’obscurité développent des germes pâles et longs qui se cassent facilement. Les longues pousses épuisent le tubercule et le font se flétrir.
Pour cela, pour la prégermination, les tubercules de semence sont placés dans un endroit frais et lumineux, en évitant la lumière directe du soleil. Dans le cas des lampes à lumière artificielle avec des tons chauds, plus de 100 W par tonne de matériel végétal sont utilisés pendant 8 à 10 heures par jour. Pour garantir l’exposition à la lumière de tous les côtés, pas plus de deux couches de pommes de terre sont étalées dans les cageots ou sur des plateaux plats.
Les tubercules de semence doivent être de taille moyenne et ne présenter aucun dommage ou signe de ravageurs ou de maladies. Les petits tubercules produiront moins de pommes de terre que les tubercules de taille moyenne.
La prégermination commence 4 à 10 semaines avant la date de plantation souhaitée, selon la variété et la température de prégermination. La température idéale pour la prégermination est de 10 à 12 °C. Plus la température est élevée pendant la prégermination, plus la germination est rapide. Une germination lente est préférable à une germination rapide.
Si nécessaire, les plants de pommes de terre peuvent être exposés à une température de 18 à 20 °C pendant 2 à 3 jours pour induire la germination. Lorsque les premiers germes émergent, la température est idéalement abaissée de nouveau à 10 à 12 °C (pommes de terre de semence : 8 à 10 °C).
L’humidité idéale de l’air est de 70 à 80 %. Si les tubercules forment trop de racines, l’humidité est trop élevée et doit être abaissée, ou bien la caissette de prégermination est placée au soleil pendant une courte période de temps.
Exercice pratique : Démonstration de la prégermination adéquate des pommes de terre de semence.
Montrez aux agriculteurs comment les tubercules de pommes de terre de semence sont prégermés et à quoi devraient ressembler les semences. Discutez avec eux comment ils peuvent pratiquer une bonne prégermination des pommes de terre sur leurs fermes.
Préparation mécanique ou manuelle du sol
La décision de la manière de travailler le sol est principalement une décision économique. Si la main-d’œuvre est bon marché et bien disponible, il est efficace de préparer la terre à la main de façon traditionnelle en utilisant des houes de main. Mais le travail physique est difficile et exerce une forte pression sur le dos. Tant qu’il y aura beaucoup de travailleurs disponibles dans les zones rurales, ce travail assurera l’emploi. Dès que les coûts de main-d’œuvre augmentent, il peut être économique de labourer le sol mécaniquement, par exemple avec des tracteurs à monoaxe, des motoculteurs ou même des gros tracteurs. La décision doit toujours reposer sur des calculs coûts-avantages.
Travail du sol primaire
La pomme de terre est tolérante à une grande variété de sols, à l’exception des sols lourds et saturés d’eau. Un bon drainage est d’une grande importance. Les sols profonds et fertiles avec une bonne rétention d’eau et une bonne aération offrent les meilleures conditions de croissance et de rendement.
La préparation du sol pour la pomme de terre sert à produire des buttes profondes et meubles pour la plantation. Les buttes doivent être exemptes de cailloux et de mottes, car elles empêchent la croissance des tubercules, provoquent des déformations et des dommages lors de la récolte mécanique.
La pomme de terre ne pousse pas bien dans un sol compacté. Pour éviter le compactage du sol ou la formation de mottes, le travail du sol primaire ne doit être effectué lorsque le sol a suffisamment séché.
Traditionnellement, la préparation du sol se fait à l’aide d’une houe manuelle, ce qui exige beaucoup de travail. Dans les sols lourds, l’utilisation d’une charrue est appropriée si une mécanisation est disponible. Une profondeur de travail de 20 cm est normalement suffisante.
En plus de créer un lit de semences meuble, le travail du sol contribue à la lutte contre les mauvaises herbes par l’incorporation des mauvaises herbes dans le sol et à la réduction de certains ravageurs et maladies. Cependant, la préparation profonde et intensive du sol nuit aux organismes du sol et peut favoriser l’érosion. Ainsi, dans les pentes, des mesures préventives contre l’érosion doivent être prises, comme la construction de digues de contour, et l’intensité du travail du sol doit être réduite. Sur les pentes raides, les pommes de terre ne doivent pas être cultivées. En général, le risque d’érosion dans la production de pommes de terre est beaucoup plus élevé que dans d’autres cultures en raison de la préparation profonde du sol, de la culture sur les buttes et de la longue période avant la fermeture de la canopée.
Préparation du lit de semence
Après la préparation primaire du sol, le sol est finement travaillé pour minimiser les mottes. Pour la culture mécanique sur des sols légers, le lit de semis peut être préparé avec un cultivateur à dents de printemps, y compris un rouleau cage. Sur les sols plus lourds, une houe rotative est couramment utilisée pour le travail mécanique du sol. Dans le cas d’un travail uniquement manuel, le sol peut être affiné par un deuxième passage avec la houe à main, brisant les plus grosses mottes.
Plus un sol est cultivé intensément, plus les agrégats du sol sont décomposés. Cela expose la matière organique du sol et accélère sa dégradation et sa perte. Un travail intensif du sol dégrade sa structure. Par conséquent, la réduction de la profondeur de travail du sol et de l’intensité de travail contribuent à améliorer la structure du sol et à réduire le risque d’érosion. De plus, moins le sol est compacté avant la plantation, mieux c’est pour la culture de pommes de terre.
Plantation
Les pommes de terre ont besoin de trois semaines jusqu’à la levée et de trois autres semaines pour couvrir adéquatement le sol. Par conséquent, sur les pentes, les pommes de terre devraient être plantées en rangées le long des courbes de niveau afin de réduire le risque d’érosion.
La distance entre les rangs peut varier de 75 à 90 cm. En cas de culture mécanique, la distance entre les rangs est généralement de 75 cm, car la plupart des machines ont une largeur de voie de 1,5 m. Une plus grande distance entre les rangs entraîne des buttes plus grandes avec un meilleur stockage de l’eau, une meilleure aération des plantes, un meilleur apport en nutriments et moins de tubercules verts. Une plus grande distance entre les rangs peut aider à réduire le risque de propagation du mildiou dans une certaine mesure. Dans certaines régions où les sols ne sont pas assez profonds pour obtenir suffisamment de terre pour le travail du sol, il est utile de laisser un plus grand espace entre les rangs.
La distance de plantation recommandée dans la ligne est de 25 à 40 cm en fonction de la distance entre les lignes, de la grandeur des pommes de terre semées, de la variété et de la taille souhaitée des tubercules récoltés. Une plus grande distance de plantation entraîne moins de tubercules, mais des tubercules plus grands. Plus la distance entre les rangs est grande, plus la distance de plantation à l’intérieur du rang est petite pour obtenir une densité de plantation favorable. Le fait de planter à de grands espaces peut entraîner la formation de mauvaises herbes, en particulier lorsque les semis sont irréguliers ou que la levée est faible. Cela peut entraîner une réduction du rendement par surface. Par conséquent, la plantation à des densités plus élevées devrait être envisagée, bien que l’augmentation de la densité des plantes réduira la taille moyenne des tubercules. Les populations de plantes inférieures à 25 000 plantes par hectare ne sont généralement pas recommandées.
Au Cameroun, les pommes de terre sont généralement plantées à la main à une profondeur de 10 à 15 cm jusqu’au sommet du tubercule. La profondeur de plantation est plus grande dans des conditions chaudes et sèches que dans des conditions fraîches et humides. Les plantations peu profondes doivent être évitées, car les nœuds inférieurs de la tige doivent rester recouverts de terre pour encourager l’initiation des tubercules et pour éviter le verdissement des tubercules et les dommages causés par la teigne de la pomme de terre. Les germes de pommes de terre de semence doivent être orientés vers le haut. Il faut faire attention à ne pas casser les germes. Des semences de même taille devraient être plantées ensemble dans une même zone afin d’assurer une culture uniforme pour une meilleure gestion.
Discussion on soil erosion
Discuter du risque d'érosion du sol dans la production de pommes de terre en tenant compte de la topographie locale, des types de sol, des conditions climatiques et des méthodes traditionnelles et nouvelles de culture du sol.
Discuter des mesures possibles pour minimiser l'érosion du sol, en utilisant des cas locaux existants.
Fertilisation
La pomme de terre réagit bien à une haute fertilité du sol. Sur les sols appauvris sans fertilisation, la culture ne produira que de faibles rendements et de petits tubercules. Par conséquent, du fumier ou du compost animal bien décomposé est nécessaire, si la terre a été continuellement cultivée. De plus, une culture légumineuse (engrais vert) fournit suffisamment d’azote.
Afin d’assurer un approvisionnement adéquat en éléments nutritifs de la culture de pommes de terre pour un bon rendement et une bonne qualité du produit, il est important de comprendre comment la plante se développe et quels sont ses besoins en éléments nutritifs au cours du cycle de production. On distingue généralement cinq stades de développement.
De la germination jusqu’à l’émergence des pousses au champ, la plante de pomme de terre dépend largement des réserves nutritives et de l’eau stockée dans le tubercule de semence. Ainsi, les petits tubercules ridés fourniront moins de nutriments et d’eau à la plante pendant la première phase de croissance.
Une fois que la plante produit des feuilles, des racines et de nouvelles pousses pendant la croissance végétative, elle dépend rapidement des éléments nutritifs du sol. De l’émergence jusqu’à l’initiation des tubercules, la culture a une forte demande en azote. Au stade du grossissement des tubercules, la plante a déjà cessé de pousser et seuls les tubercules deviennent plus gros.
Besoins spécifiques en nutriments de la pomme de terre
L’approche générale de l’agriculture biologique en matière de nutrition des plantes consiste à promouvoir l’activité biologique du sol et non à fournir des nutriments spécifiques sous une forme facilement accessible aux plantes. Néanmoins, il peut être pertinent de comprendre les besoins spécifiques en nutriments de la plante de pomme de terre pour obtenir de bons rendements et une bonne qualité des tubercules.
Potassium
La pomme de terre est l’une des cultures dont la demande en potassium est la plus forte. Le potassium est important pour le développement de l’amidon. De plus, il améliore la durée de conservation et réduit le nombre de tubercules endommagés. Il augmente également la quantité d’acides organiques et la teneur en vitamine C dans les tubercules. Il en résulte une diminution de la décoloration à l’état brut et après cuisson, ainsi qu’une réduction des blessures. Cependant, une surproduction de potassium peut avoir un impact négatif sur la matière sèche et la teneur en amidon des tubercules.
Les sols latéritiques acides typiques sont pauvres en potassium. Ainsi, un apport approprié de potassium dans le sol peut être décisif pour obtenir de bons rendements. Les grands fournisseurs de potassium sont la cendre de bois, le fumier animal, le lisier et le compost. S’ils ne sont pas disponibles, les engrais potassiques approuvés pour l’agriculture biologique, comme le patentkali, peuvent être utilisés. Le chlorure de potassium doit être évité, car cet engrais a un impact négatif sur la pomme de terre. Un hectare de pommes de terre avec un rendement de 30 tonnes nécessite environ 200 kg de K.
Azote
Jusqu’à la levée, les plants de pomme de terre n’ont pas besoin d’azote, car ils puisent dans les réserves du tubercule mère. La majeure partie de l’azote est nécessaire pendant la courte période entre la levée et le développement des tubercules pour la production de matériel végétal vert. Un apport approprié d’azote dans les 35 à 50 premiers jours après la levée entraîne une forte croissance des feuilles et une bonne croissance des tubercules. Plus il y a d’azote stocké dans les feuilles, plus les tubercules se développent chaque jour, et plus la production de rendement dure longtemps (à moins que le mildiou n’apparaisse pas).
Pendant la formation des tubercules, la plante continue d’extraire l’azote du sol, mais la majeure partie de l’azote est transférée des feuilles. Lorsque l’apport d’azote dans les feuilles est épuisé, les tubercules arrivent à maturité. Dans certains cas, un apport élevé d’azote peut entraîner une augmentation des cœurs creux dans les gros tubercules, une croissance secondaire et des déchirures de croissance.
Si l’apport d’azote est trop élevé, le développement constant de nouvelles feuilles et tiges donnera un feuillage large et dense. Cela peut retarder la formation et la croissance des tubercules. Une infestation précoce du mildiou peut entraîner des pertes de rendement. En outre, un apport d’azote trop élevé et trop tardif a un impact négatif sur la matière sèche et la teneur en amidon des tubercules et la saveur. De plus, il augmente la susceptibilité aux dommages et à la décoloration à l’état brut et après cuisson, et réduit la possibilité de stockage. Une libération trop élevée d’azote avec un faible apport en potassium en même temps nuit à la maturation en raison de la reprise de la germination. Ceci, à son tour, complique le défanage.
Les agriculteurs biologiques n’utilisent que des sources d’azote organiques, y compris les engrais de ferme, les engrais verts de légumineuses et les légumineuses à grains. Le dégagement d’azote à partir de ces sources dépend de la teneur en azote de la source, de son rapport C:N et des conditions de minéralisation dans le sol. Plus l’activité biologique d’un sol est élevée, plus sa teneur en matière organique est élevée, et plus le sol est aéré et humide, plus la minéralisation azotée est élevée (en plus de la température).
La demande en azote des pommes de terre dépend de différents facteurs tels que les rendements escomptés, la variété et les conditions de croissance. Elle peut varier de 80 à 200 kg par hectare. Les sols biologiquement actifs fournissent environ 20 kg de N par hectare (plus la fertilisation ou la quantité de résidus de pré-récolte est élevée, plus la minéralisation de l’azote dans le sol est élevée) dans des conditions de minéralisation favorables pendant la période de végétation. A chaque buttage et binage, 10 à 20 kg d’azote supplémentaire par hectare sont minéralisés.
Les engrais verts de légumineuses en pré-récolte peuvent fournir 50 à 150 kg d’azote disponible par hectare, si les conditions de minéralisation et le moment sont bonnes. Les légumineuses à graines laissent, selon les espèces, entre 30 et 100 kg d’azote disponible par hectare à la culture suivante (soja 30 kg, pois céréaliers : 50 à 80 kg, féveroles : jusqu’à 100 kg).
Phosphore
Comparé au potassium, les besoins en phosphore de la pomme de terre sont très faibles. Les besoins en phosphore sont mieux satisfaits avec du compost ou du fumier. Si un supplément de phosphore est nécessaire, des phosphates de roche ou du fumier de poulet biologique peuvent être utilisés comme suppléments. En raison de la faible disponibilité du phosphore dans les sols latéritiques, l’ajout de matière organique au sol améliorera la disponibilité du phosphore. Grâce à son pH neutre, le compost améliore la disponibilité des nutriments dans les sols acides. Les engrais de ferme et les engrais verts sont d’autres engrais organiques appropriés dans ces sols.
Utilisation d'engrais
L’utilisation d’engrais organiques provenants de la ferme ou disponibles localement augmente non seulement l’apport de nutriments aux cultures, mais elle réduit également les coûts de production par rapport à l’utilisation d’engrais commerciaux et limite la dépendance à l’égard des sources externes d’intrants.
La source d’éléments nutritifs la plus précieuse pour les producteurs de pommes de terre au Cameroun peut être l’engrais vert, car les engrais verts présentent plusieurs avantages par rapport à d’autres sources (voir chapitre 2.3.2). Malheureusement, de nombreux agriculteurs africains n’exploitent pas encore le potentiel des engrais verts légumineux et des cultures de couverture dans la gestion de la fertilité des sols. Le principal défi lié aux engrais verts est de trouver des espèces appropriées qui s’adaptent bien au climat local et au système de culture local.
Le fumier animal peut être recommandé pour la fertilisation de base des pommes de terre. Cependant, de nombreux agriculteurs camerounais n’ont pas d’animaux de ferme. Par conséquent, la collaboration avec les éleveurs de bétail proches peut être une option. Idéalement, le fumier animal devrait être entreposé pendant 60 à 90 jours avant l’application ou composté en même temps que le matériel végétal.
Le fumier de bovins est riche en potassium, alors que le fumier de porc contient moins de K, mais plus de phosphore. Le fumier de volaille contient environ trois fois plus d’azote, quatre fois plus de phosphore et de potassium que le fumier de bovins. Cela explique en partie pourquoi le fumier de volaille est si recherché par les agriculteurs camerounais. Le fumier, le fumier composté et d’autres composts fournissent beaucoup de potassium et de magnésium. Cependant, le fumier composté a un effet beaucoup plus faible sur l’apport d’azote que le fumier empilé. Le lisier de bovins est relativement élevé en K et N. Par contre, le lisier de porc a des teneurs en N et P plus élevées. Alors que les fumiers et les lisiers ont principalement un effet fertilisant à court terme, mais un faible effet sur la construction du sol à long terme, les fumiers compostés ont un effet positif plus élevé sur la fertilité du sol et l’activité biologique du sol.
Les fumiers et les lisiers devraient être appliqués sur la culture précédente ou avant la plantation des pommes de terre, et non directement sur à la culture de pommes de terre. Pour prévenir les maladies d’origine alimentaire causées par Escherichia coli ou d’autres bactéries, le fumier ne devrait jamais être utilisé comme épandage en surface, mais devrait être appliqué au moins 120 jours avant la récolte. L’épandage de fumier sur la culture précédente réduit le risque d’infestation par le Rhizoctonia. Le fumier et le lisier devraient être travaillés dans le sol immédiatement après l’application afin de prévenir les pertes d’azote par volatilisation.
En règle générale, il ne faut pas utiliser plus de 25 à 30 tonnes de fumier ou 15 à 30 m3 de lisier par hectare, car des doses trop élevées entraînent un apport prolongé d’azote dans la culture de pommes de terre et entravent sa maturation. En cas de sécheresse ou de sols lourds, la culture suivante pourrait bénéficier davantage des éléments nutritifs que la culture de pommes de terre elle-même.
Une dose équilibrée de fumier peut avoir un effet positif sur la teneur en K des tubercules, alors qu’une fertilisation excessive avec du fumier entraîne une diminution de la teneur en amidon et en matière sèche dans les tubercules. Des doses de boue et d’azote trop élevées peuvent augmenter la teneur en nitrate et diminuer la teneur en matière sèche et en amidon dans les tubercules.
Il est également possible d’utiliser des composts faits de matériaux végétaux. Ils fournissent au sol à la fois des macronutriments (nutriments requis en plus grande quantité) comme N, K, Ca, Mg, P et S, et des micronutriments (nutriments requis en plus petite quantité) comme Cl, Fe, B et Mn. Les composts ont l’avantage supplémentaire de réprimer les maladies des plantes transmises par le sol, s’ils sont appliqués sur une base régulière. Le compost provenant du matériel végétal appliqué dans les sillons de plantation peut réduire l’infestation par Rhizoctonia.
Le compost doit être suffisamment décomposé et exempt de maladies de la pomme de terre. Cela nécessite un compostage approprié (pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre 2.3.3.3). Les tubercules de pommes de terre résiduaires et le matériel de culture de pommes de terre malades ne doivent pas être utilisés avec d’autres matériaux de compostage. Au lieu de cela, ils devraient être enfouis profondément dans le sol pour éviter d’autres infections des plantes.
Si des engrais organiques azotés commerciaux sont utilisés, seuls des engrais à minéralisation rapide de l’azote devraient être utilisés (comme les féveroles finement moulues). Ces engrais doivent être appliqués au moment de la plantation ou au plus tard lors du premier binage de la culture. En raison des coûts élevés, les engrais organiques azotés commerciaux ne sont recommandés que s’il n’y a pas suffisamment d’azote provenant d’engrais verts ou d’engrais de ferme.
Dans les systèmes européens de certification biologique, l’utilisation d’engrais minéraux potassiques n’est autorisée que si la carence du sol est prouvée par l’analyse du sol. Dans les sols acides il est préférable d’appliquer le potassium sous forme de patentkali.
La chaux ne devrait pas être appliquée sur la pomme de terre, car elle augmente le risque d’infection par la tavelure. Lorsque le sol est très acide (pH inférieur à 5,5), il faut appliquer de la chaux sur la culture précédente.
Le magnésium est particulièrement important (surtout dans les sols légers qui peuvent ne pas fournir suffisamment de magnésium), tout comme le bore et le manganèse pour un bon rendement et une bonne qualité. Les analyses de sol montrent s’il y a une carence de ces nutriments dans le sol ou non. Dans les systèmes européens de certification de l’agriculture biologique, l’utilisation d’engrais à base de feuilles et d’oligo-éléments doit être documentée par les agriculteurs, par exemple en effectuant des analyses de sol ou de feuilles.
Afin d’accroître la résilience et la fertilité des plantes, certains agriculteurs biologiques utilisent des fortifiants et des toniques. Exemples : lactosérum, farine de pierre, composés avec des micro-organismes, extraits de plantes, thés de compost ou tisanes. Dans de nombreux cas, l’effet et le mode d’action n’ont pas encore été étudiés ou clarifiés, et les augmentations de rendement qui en résultent n’ont pas été scientifiquement prouvées.
Les engrais sont préférablement appliqués avant ou pendant la préparation du sol, car ceci permet de bien les incorporer dans le sol. Si les engrais sont placés juste sous les tubercules, la concentration élevée d’éléments nutritifs autour des tubercules peut causer des brûlures. De plus, la plante de pomme de terre produira moins de racines pour accéder aux nutriments et sera donc moins résistante à la sécheresse.
Discussion sur les engrais et autres sources d’éléments nutritifs pour la pomme de terre
Demandez aux agriculteurs quels engrais de ferme ils utilisent et quels autres engrais organiques (commerciaux) sont disponibles. Évaluez les engrais en fonction de leur conformité aux principes de l’agriculture biologique, de la qualité des engrais, du prix et d’autres critères. Discutez avec les agriculteurs de leurs expériences avec ces engrais. Mentionnez d’autres engrais qui n’ont pas été mentionnés, comme les engrais verts ou le compost peut-être. Déterminez l’acceptation de nouvelles sources de nutriments parmi les agriculteurs.
Désherbage mécanique
Jusqu’à la fermeture de la canopée, la pomme de terre tolère peu de concurrence des mauvaises herbes. Cela signifie que des conditions sans mauvaises herbes doivent être maintenues jusque-là. La lutte directe contre les mauvaises herbes en complément des mesures préventives dans la production biologique de pommes de terre est généralement réalisée à l’aide de méthodes mécaniques. L’utilisation d’herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes n’est pas autorisée dans l’agriculture biologique certifiée. La lutte thermique contre les mauvaises herbes à la flamme serait trop coûteuse dans le contexte camerounais. Si le désherbage mécanique est effectué correctement, le désherbage manuel n’est généralement pas nécessaire.
Mesures préventives
Les mesures préventives dans la lutte biologique contre les mauvaises herbes comprennent un bon travail du sol, la sélection de variétés compétitives avec un développement rapide en jeunesse et une forte formation foliaire ainsi qu’un système de rotation des cultures qui empêche le développement des mauvaises herbes. La culture d’engrais verts est particulièrement efficace contre les mauvaises herbes.
Buttage
La lutte contre les mauvaises herbes dans la production biologique de pommes de terre est étroitement liée au buttage. Le buttage sert à recouvrir les tubercules et les stolons pour prévenir des tubercules verts toxiques, à protéger les tubercules contre les ravageurs comme la teigne de la pomme de terre et à créer de grandes buttes stables pour encourager la production de nouveaux tubercules. En outre, le déplacement du sol en vue du buttage casse la surface du sol et améliore l’aération et l’infiltration de l’eau dans les buttes. Ceci conduit à une meilleure minéralisation des engrais organiques et améliore la disponibilité des nutriments pour les plantes. En même temps, le buttage supprime les mauvaises herbes jusqu’à ce que la canopée couvre le sol.
La lutte contre les mauvaises herbes est importante, car les mauvaises herbes peuvent concurrencer la pomme de terre pour la lumière, les nutriments et l’eau. Si les mauvaises herbes ne sont pas éliminées, le rendement des cultures peut être fortement réduit et les maladies et les ravageurs peuvent être encouragés. Ainsi, le désherbage et le buttage sont deux opérations importantes après la plantation des pommes de terre. Une forte croissance des feuilles basée sur un bon apport d’azote conduit à une couverture précoce du sol et donc à une meilleure suppression des mauvaises herbes.
Au Cameroun, la plupart des petits producteurs utiliseront la houe traditionnelle pour le buttage. Le buttage, qu’il soit fait avec une houe manuelle ou une machine, doit être exécuté avec soin, car il peut endommager les racines fines et délicates des plants de pommes de terre sur les côtés de la butte et peut endommager les feuilles, les stolons et les petits tubercules, ce qui réduira le rendement. Les racines et les feuilles peuvent alors offrir des moyens aux maladies de pénétrer dans la plante. Tout travail de désherbage mécanique doit toujours être effectué lorsque le sol est suffisamment sec pour éviter d’endommager la structure du sol. De préférence, le buttage est effectué le soir, lorsque les feuilles de pomme de terre sont dressées, car cela réduit le risque de les recouvrir de terre.
Outils standard
Traditionnellement, en Afrique de l’Ouest, le buttage se fait à l’aide de pelles à main. Les agriculteurs équipés mécaniquement utiliseront une houe rotative, une herse étrille, une sarcleuse à socs et / ou une butteuse pour la gestion des mauvaises herbes. La houe rotative fait des buttes bien couvertes, mais n’est pas applicable sur des sols très caillouteux, et est moins adaptée au buttage à l’extrémité des rangs. En plus, elle perturbe davantage le sol et entraîne un risque de battance. Il n’est recommandé que pour les sols difficiles et cohésifs. Les planches de buttage peuvent être recommandées pour le dernier passage de labour. L’équipement de buttage avec des socs à pattes d’oie rigides ne devrait être utilisé que lorsqu’il n’y a pas de risque d’endommager les racines des pommes de terre. Il existe des appareils polyvalents qui complètent le hersage, le buttage et éventuellement le sarclage en une seule opération.
Procédé
Du point de vue de la lutte contre les mauvaises herbes, le moment idéal pour lutter contre les mauvaises herbes est avant que les mauvaises herbes ne deviennent visibles (au stade du fil blanc / prélevée) ; au plus tard lorsque les mauvaises herbes atteignent le stade à deux feuilles. Le passage des rangs à l’aide d’une herse à dents avant la levée de la culture (hersage à l’aveugle) permet une première suppression précoce des mauvaises herbes.
Les plants de pommes de terre nouvellement émergés sont sensibles et ne devraient pas être hersés. Les pommes de terre sont généralement cultivées deux fois : une première fois lorsque les plantes sont hautes d’une main, et une deuxième fois 3–4 semaines plus tard. Si le buttage est effectué correctement, les mauvaises herbes sont efficacement contrôlées. Dans le contexte camerounais, le billonnage est généralement suffisant pour lutter contre les mauvaises herbes. Lors de la première récolte, le sol est tiré doucement vers le haut autour des plants de pommes de terre en construisant des buttes homogènes. Les plantes dont les feuilles ont une taille supérieure à celle d’un poing ne devraient plus être couvertes de terre. Après le premier buttage, la hauteur des buttes doit être d’environ 30 cm. Au deuxième buttage, le sol est déplacé des sillons vers le haut des buttes.
En cas de désherbage mécanique, seuls des tracteurs légers à pneus étroits doivent être utilisés dans la culture, afin d’éviter le compactage des buttes.
Discussion et démonstration
Invitez les agriculteurs à partager leurs expériences en matière de lutte contre les mauvaises herbes. Tirez ensemble des conclusions sur les principes de lutte contre les mauvaises herbes. Ajoutez des informations, si des aspects importants n’ont pas été mentionnés. Si possible, emmenez les agriculteurs dans un champ de pommes de terre et montrez-leur quand les mauvaises herbes sont mieux contrôlées et comment éviter d’endommager la culture.
Irrigation
Un approvisionnement en eau adéquat est essentiel à tous les stades de croissance pour obtenir des rendements optimaux de pommes de terre, une bonne qualité des tubercules et une sécurité de rendement. Une culture de pommes de terre a besoin, en fonction du stade de croissance, d’environ 20 litres d’eau par m2 par semaine. En raison des besoins élevés en eau de la culture, la plupart des agriculteurs camerounais cultivent des pommes de terre de mars à juin, lorsque les pluies sont régulières et modérées. Toutefois, il est recommandé aux agriculteurs ayant accès à l’eau d’irrigation de cultiver des pommes de terre en période sèche plutôt que pendant la saison des pluies, car le risque d’infection par le mildiou est fortement réduit. Des prix plus élevés des pommes de terre peuvent rembourser les investissements dans le matériel d’irrigation à long terme.
Une teneur élevée en matière organique du sol contribue à une meilleure rétention d’eau dans le sol et, par conséquent, à une utilisation plus efficace de l’eau. Par conséquent, les investissements à moyen et long terme dans la fertilité des sols, y compris l’engrais vert, le compostage, les cultures de couverture et le paillage sont également pertinents si l’irrigation est disponible.
Besoins en eau de la pomme de terre
- Si la culture est cultivée pendant la saison sèche ou dans des zones où les précipitations sont faibles ou irrégulières, elle dépend d’une irrigation régulière, en particulier sur des sols plus légers. En cas de pluies irrégulières, un collecteur de pluie indiquera combien de litres sont tombés avec les pluies sur un mètre carré.
- Un sol sec au début du développement de la culture favorise un système racinaire large. Les périodes de sécheresse pendant la formation des tubercules entraînent une réduction de la formation des tubercules et donc des pertes de rendement et de qualité. De l’autre côté, un sol très humide au début de la croissance des tubercules peut favoriser l’infection par la gale poudreuse (S. subterranea) par les lenticelles et parfois par les yeux ou les plaies.
- L’irrigation précoce favorise la minéralisation biologique de la matière organique et améliore ainsi l’apport d’azote du sol. Après le début de l’allongement des tiges, le sol doit être maintenu humide, sinon la formation des tubercules pourrait commencer trop tôt et plus d’une génération de tubercules pourrait se former.
- Pendant la croissance des tubercules, la teneur en eau du sol est cruciale pour la production de rendement, surtout à partir de 3 semaines après la floraison jusqu’à la maturation. Une humidité suffisante du sol au moment de la formation des tubercules (initiation) prévient l’infection par la gale commune (S. scabies). Une humidité suffisante du sol pendant le développement des tubercules réduit la croissance secondaire et les déchirures de croissance, et conduit à une qualité de cuisson uniforme.
Systèmes d'irrigation
L’irrigation goutte à goutte est la technique d’irrigation la plus adaptée et la plus efficace, car elle réduit l’humidité dans la canopée, ce qui minimise le risque d’infection par le mildiou et permet d’économiser de l’eau. L’irrigation par sillon n’est pas recommandée, car les pommes de terre sont très sensibles à l’engorgement d’eau et aux maladies bactériennes car le flétrissement bactérien et la jambe noire sont dispersés et favorisés. L’irrigation par sillon augmente également l’envasement du sol, endommage les crêtes, nécessite de grandes quantités d’eau et distribue l’eau de façon inégale.
Visite d’une ferme avec irrigation
Emmenez les agriculteurs dans une ferme avec irrigation et profitez de l’occasion pour discuter des avantages, des risques et des possibilités des différents systèmes d’irrigation.
Procédé
- De la formation des tubercules à la floraison, la teneur en eau à l’intérieur de la butte doit être maintenue à un minimum de 50 % de la capacité du champ (la capacité du champ étant la quantité d’eau contenue dans le sol après que l’excès d’eau s’est drainé et lorsque le drainage cesse). Cela se produit généralement 2 à 3 jours après la pluie ou l’irrigation.
- Selon le sol et le stade de développement de la culture de pommes de terre, les taux d’irrigation sont de 20 à 35 mm par application. Le sol ne doit pas être rempli par arrosage à plus de 80 à 90 % de la capacité utile du champ pour éviter les pertes d’eau et le drainage des nutriments. Cela signifie que le sol ne doit jamais être complètement saturé d’eau.
Lutte contre les ravageurs et les maladies
La gestion des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes est un défi pour la plupart des agriculteurs en Afrique. La grande diversité des ravageurs et des maladies, les connaissances limitées sur les caractéristiques et les cycles des pathogènes font qu’il est difficile de choisir les bonnes mesures de prévention et de lutte directe. Les agriculteurs doivent savoir quels agents pathogènes causent des dégâts dans les champs. La détermination adéquate de l’agent pathogène est le premier pas vers une gestion efficace des parasites et des maladies.
Les connaissances limitées sur les pesticides biologiques appropriés et l’accès limité à ces pesticides en raison des contraintes financières et de disponibilité posent des défis à la lutte contre les ravageurs et les maladies. Pour éviter des pertes de récoltes importantes, les agriculteurs devraient pouvoir mettre en œuvre des mesures abordables et efficaces sans augmenter substantiellement les coûts de production ou nuire aux organismes bénéfiques dans le champ.
Les agriculteurs biologiques accordent beaucoup d’attention à la prévention de la propagation et la multiplication des ravageurs et des maladies en gérant correctement les cultures. Une prévention efficace minimise les mesures de contrôle direct coûteuses. Idéalement, la lutte contre les parasites et les maladies exige un coût supplémentaire minimal et utilise des techniques faciles à préparer et à appliquer, efficaces dans les conditions locales, sûres à manipuler et n’ayant qu’un effet négatif minime ou nul sur d’autres organismes, sur l’eau, le sol, l’air et les produits agricoles.
Approche en trois pas
L’agriculture biologique s’oriente vers une approche en trois pas pour la gestion des ravageurs et des maladies, où chaque pas constitue la base pour le pas suivant : pas 1 : gestion du sol et des cultures ; pas 2 : gestion de l’habitat ; pas 3 : contrôle direct. L’objectif est d’optimiser les pratiques du premier et du deuxième pas qui encouragent l’autocontrôle naturel des ravageurs et des agents pathogènes, et de minimiser les mesures de lutte directe. Pour des informations détaillées sur l’approche en trois pas pour la gestion des ravageurs et des maladies dans les cultures biologiques, veuillez consulter le Manuel africain de formation, Module 4, disponible gratuitement à l’adresse www.organic-africa.net.
En ce qui concerne la lutte contre les ravageurs et les maladies en général, une approche systémique intégrée devrait également être adoptée pour la lutte contre les ravageurs et les maladies dans la production de pommes de terre. Une telle approche fait appel (i) à des variétés résistantes / tolérantes, (ii) aux stratégies de lutte agronomique disponibles telles que la rotation des cultures avec prise en compte des pauses nécessaires et un système de culture optimisé, (iii) aux traitements alternatifs (par exemple, les pesticides biologiques, les fortifiants des plantes et les agents de biocontrôle qui peuvent remplacer les fongicides synthétiques et à base de cuivre) et (iv) aux traitements d’optimisation utilisant des systèmes de prévision (si disponibles) afin de maximiser les interactions synergiques entre (i), (ii), (iii), (iii) et (iv).
Principales maladies de la pomme de terre
Les principales maladies de la pomme de terre au Cameroun sont le mildiou, le flétrissement bactérien et la jambe noire.
Le mildiou
Cette importante maladie est causée par le champignon Phytophthora infestans. Elle infecte régulièrement les plantes à partir du stade d’initiation du tubercule jusqu’à la récolte et provoque souvent des pertes de rendement élevées. Les infections sont encouragées par la pluie, une humidité élevée et des températures basses. Cette maladie agit très rapidement.
Symptômes
Les symptômes comprennent des taches brunes, en partie huileuses avec une transition floue vert clair vers des tissus sains, sur la face supérieure des feuilles et sur les tiges. Sur la face inférieure des feuilles, on trouve des taches grises/noires et une croissance fongique blanche (ressemblant à de la farine) après une pluie ou la rosée du matin (surtout sur le bord). Par temps sec la croissance fongique peut être cultivée en gardant une feuille dans un sac humide pendant la nuit pour former le mycélium blanc et faciliter l’identification. Les infections graves provoquent la pourriture de toutes les feuilles, le dessèchement et la chute au sol, le dessèchement des tiges et la mort des plantes. En cas de fortes pluies, les spores des feuilles peuvent être lavées dans les billons et infecter les tubercules. Ceux-ci brunissent et présentent des pourritures humides et sèches. La chair des tubercules ouverts coupés est également brune.
La maladie ne doit pas être confondue avec les ’coups de soleil’ ou le mildiou (les deux n’ont pas de zone de transition autour des taches foliaires) ou la pourriture grise (croissance fongique grise à la surface/en dessous des feuilles).
Source et propagation
L’infection initiale des feuilles peut être provoquée par du matériel de plantation infecté (latent), des pommes de terre spontanées ou des tubercules sur des tas de compost, ou elle peut être provoquée par le vent à une plus grande distance. Les tubercules sont infectés par infiltration de spores provenant de feuilles infectées ou par infection par frottis pendant la récolte.
La transmission des spores par l’air se produit lorsque l’humidité relative de l’air est supérieure à 90 % et que la température est d’environ 18 °C. Pour que les spores infestent la plante, il faut des gouttes d’eau à la surface. L’humidité des feuilles est donc un facteur important dans le développement de la maladie. Si l’infection est très probable, le champignon peut infecter une culture entière en quelques jours. Selon les conditions météorologiques, il faut entre 2 à 3 semaines et 2 mois pour que les plantes meurent après l’infection initiale. Par temps sec, l’infection cesse de se propager ; par temps humide, elle augmente.
Gestion
Prévention :
Les meilleures mesures de prévention sont les suivantes:
(i) L’utilisation de variétés résistantes ou hautement tolérantes à croissance rapide des tubercules. Afin de réduire le risque de perdre la résistance de certaines variétés, il convient de cultiver différentes variétés en rangées séparées. Les variétés plus sensibles doivent être cultivées sur le côté du champ sous le vent de la direction du vent dominant. L’alternance de cultures en rangées de variétés sensibles et de variétés moins sensibles peut retarder la propagation de la maladie.
(ii) La plantation de tubercules sains réduit le risque d’apparition précoce de la maladie. La pré-germination des semences découvre les tubercules infectés, car ils commencent à pourrir pendant la pré-germination et peuvent être enlevés et éliminés. La pré-germination raccourcit également la période de récolte. Les tubercules mis au rebut doivent être compostés à 60 °C ou enfouis dans un trou profond et recouverts de terre.
(iii) Choisir des endroits bien aérés qui permettent à la culture de sécher rapidement après la pluie ou la rosée.
(iv) Éviter un espacement étroit, car cela augmentera l’humidité dans la culture et favorisera les infections par le mildiou.
(v) La plantation d’une bande d’au moins 12 m d’une culture différente, comme le maïs perpendiculairement à la direction des vents dominants, retarde également la propagation de la maladie.
(vi) Éviter un apport excessif d’azote, car cela rend les plantes plus sensibles.
(vii) Éviter les infestations importantes de mauvaises herbes pour permettre un séchage plus rapide de la culture.
(viii) Éviter les pommes de terre spontanées dans les cultures suivantes. Les porcs peuvent être efficaces pour enlever ces tubercules.
(ix) Enlever les plants de pommes de terre des tas de déchets ou les recouvrir de terre.
Le contrôle de la maladie est le plus probable aux premiers stades de l’infection. C’est pourquoi les cultures doivent être contrôlées tous les deux jours le matin pour détecter les symptômes typiques. Toutes les plantes ou tous les foyers infectés identifiés doivent être retirés et brûlés ou enfouis.
Le déchaumage à temps (réduire le feuillage lorsque les tubercules atteignent leur taille optimale) peut aider à prévenir le passage de la maladie du feuillage aux tubercules ou aux plantes de pomme de terre voisines.
Protection préventive :
Dans la pratique, les fortifiants, tels que la poussière de roche, la tithonia, le lait écrémé ou le lactosérum et le thé de compost, sont souvent utilisés pour protéger les cultures de pommes de terre contre le mildiou et lutter contre la maladie. Selon l’expérience pratique, la poussière de roche favorise le séchage des feuilles. Cependant, les tests scientifiques effectués par FiBL n’ont pas pu prouver une efficacité suffisante de ces agents pour la lutte contre le mildiou. Dans des conditions d’humidité limitée (et donc de pression modérée de la maladie), et dans les variétés tolérantes, l’utilisation de poussière de roche ou de tithonia ou de compost peut être suffisante.
Au Cameroun, de nombreux agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires de fabrication artisanale, à base de feuilles macérées de papaye, de tithonia, de cendre de bois, de charbon de bois ou d’autres matières premières. Le savon et le neem sont fréquemment utilisés comme insecticide. Des micro-organismes efficaces (EM) disponibles dans le commerce sont utilisés par certains agriculteurs comme agent phytosanitaire universel. L’efficacité de ces produits (sauf pour le savon et le neem) n’est pas prouvée. L’application d’un mélange d’orties et d’Omo (le détergent à lessive commercial) a été partiellement efficace au Kenya.
Le produit phytosanitaire le plus efficace dont disposent les agriculteurs biologiques pour lutter contre le mildiou est le cuivre inorganique. Le cuivre protège durablement les plantes contre différentes maladies fongiques et bactériennes telles que le mildiou.
Cependant, le cuivre a un inconvénient majeur : En tant que métal lourd, il s’accumule dans la couche arable et, à des doses élevées, agit comme toxique pour les micro-organismes et les vers de terre du sol. Ainsi, elle peut également inhiber la minéralisation microbienne de l’azote, ce qui est important dans l’agriculture biologique. Le cuivre est également toxique pour les poissons et le bétail, car il provoque des troubles gastro-intestinaux sévères chez l’homme. L’avenir à long terme du cuivre destiné à l’agriculture biologique certifiée pour la lutte contre le mildiou est incertain. D’autres substances actives font l’objet de recherches depuis des années. Les premiers produits efficaces pourraient être disponibles dans les années à venir (peut-être pas aussi vite en Afrique).
Les produits à base de cuivre sont enregistrés et disponibles au Cameroun. Cependant, jusqu’à présent, le cuivre n’a pas été utilisé par de nombreux producteurs de pommes de terre au Cameroun.
Il existe différentes préparations de cuivre dont la teneur en cuivre se situe entre 20 et 50 %. Dans l’agriculture biologique, l’hydroxyde de cuivre et l’oxychlorure de cuivre sont couramment utilisés. Il existe également des combinaisons des deux. Les différentes formulations de cuivre ne présentent pratiquement aucune différence d’efficacité. Un produit traditionnel à base de cuivre est la bouillie bordelaise, qui est une combinaison de sulfate de cuivre, de chaux et d’eau. La bouillie bordelaise adhère très bien aux plantes par temps de pluie, mais laisse une décoloration bleu-vert sur les plantes. La bouillie bordelaise est disponible dans le commerce en emballages pré-mélangés ou peut être préparée individuellement.
L’efficacité de la bouillie bordelaise dépend de sa bonne préparation. Pour faire le mélange, diluer 100 grammes de chaux hydratée (ou chaux de construction, c’est-à-dire la chaux utilisée pour mélanger le ciment) dans 5 litres d’eau jusqu’à ce que la chaux se soit complètement dissoute dans l’eau. Ensuite, diluer 100 grammes de sulfate de cuivre dans environ 5 litres d’eau. Verser progressivement la chaux diluée dans les 5 litres de sulfate de cuivre dilué tout en mélangeant bien les deux. Ce procédé permet d’obtenir 10 litres de bouillie bordelaise prête à l’emploi. Ne préparer que la quantité de mélange qui sera utilisée par la suite. La solution de pulvérisation doit être utilisée peu de temps après sa préparation, car le mélange se détériorera à l’arrêt. Si un agent mouillant est ajouté à une préparation à base de cuivre, par exemple du savon pur sans additifs, la quantité de cuivre peut être réduite.
Le cuivre doit toujours être appliqué préventivement, c’est-à-dire avant l’infection et avant les pluies. Il peut protéger les plantes saines, mais ne peut pas guérir les plantes infectées. Après l’infection, le champignon ne peut pas être empêché de se propager à travers la plante. Les plantes affectées doivent être enlevées et la protection des cultures saines doit être renforcée. Avec tous les sprays cuivre, un revêtement de cuivre uniforme sur les faces supérieure et inférieure des feuilles est essentiel pour donner aux plantes la protection désirée. La bouillie doit recouvrir toutes les parties de la plante pour assurer une bonne protection. Ceci peut être réalisé avec des pulvérisateurs à commande manuelle, des pulvérisateurs à moteur ou des pulvérisateurs à tracteur. 400 à 1000 litres par hectare doivent être utilisés pour assurer un bon mouillage.
Tant qu’aucune infestation n’est détectée dans la région dans un rayon d’environ 50 km, aucun traitement n’est nécessaire. Les applications doivent commencer dès que des symptômes sont signalés dans la région. Lorsque le mildiou se produit dans la région, mais qu’aucune infection n’est visible dans les champs voisins et dans les champs propres, la protection de la culture avec une dose réduite de 200 à 300 g de cuivre pur par hectare est en général suffisante.
En cas d’infections :
Dès que le mildiou apparaît dans les champs propres ou voisins, la dose des traitements doit être augmentée à 800 à 1000 g de cuivre pur par hectare.
De plus, les plantes malades doivent être arrachées en enlevant les tiges et le feuillage dans un rayon de 3 m autour de l’infection, laissant les tubercules dans le sol. Enlever les feuilles et les tiges du champ et les enterrer dans un trou.
Si au moins 30 mm de précipitations sont tombés depuis la dernière application, ou si de nombreuses nouvelles feuilles ont été formées depuis lors, le revêtement doit être renouvelé. Le traitement doit être répété au plus tard après une semaine.
Récolter les tubercules des plantes coupées après 2 à 3 semaines. Cela permet à la peau des tubercules de se solidifier, ce qui réduit le risque d’infection par des feuilles sporulantes pendant la récolte.
La dose maximale autorisée d’application de cuivre par hectare et par an dans les programmes d’agriculture biologique certifiée se situe entre 2 et 6 kg de cuivre pur par hectare et par an.
Flétrissement bactérien
Le flétrissement bactérien est causé par la bactérie Ralstonia solanacearum (anciennement connue sous le nom de Pseudomonas solanacearum). Cette maladie est extrêmement dangereuse, surtout dans les régions où la pomme de terre est cultivée intensivement. Outre la pomme de terre, le pathogène infecte également d’autres cultures de la famille des solanacées comme le chili, la tomate, le tabac et l’aubergine. Il se propage également sur plusieurs espèces de mauvaises herbes. Dans certaines régions, c’est la principale cause de réduction de la production.
Symptômes
Cette maladie provoque un flétrissement et une mort rapides de la plante entière, sans jaunissement ni taches sur les feuilles. Toutes les branches se flétrissent à peu près en même temps. Le premier symptôme visible est un flétrissement des feuilles à l'extrémité des branches pendant la chaleur de la journée et souvent l'après-midi. La nuit, les feuilles flétries se rétablissent. La raison de ce flétrissement est l'interruption de l'alimentation en eau de la plante, car les bactéries présentes à l'intérieur de la plante obstruent les faisceaux vasculaires. Lorsque la maladie se développe, un anneau de couleur brune est visible en raison de la pourriture de l'anneau vasculaire, lorsque les tiges sont coupées. Les feuilles prennent une teinte bronze.
Les tubercules légèrement infectés ne présentent aucun signe extérieur de la maladie, mais lorsqu'un tubercule est coupé en deux, des anneaux noirs ou bruns sont visibles. Si on les laisse reposer un certain temps ou si on les presse, ces anneaux exsudent un liquide blanc épais. La terre collée aux yeux du tubercule lors de la récolte est également un signe typique. Une infection grave entraîne la pourriture des tubercules. La pourriture caractéristique causée par le flétrissement bactérien produit une très mauvaise odeur.
Source et propagation
Le flétrissement bactérien peut se propager rapidement sur l’eau, le sol, les plantes, les parties de plantes comme les tubercules de semence et les plants de pommes de terre spontanées, les outils de coupe, le bétail et les humains, et être transféré à des plantes saines. Mais il peut aussi être transmis par d’autres plantes cultivées ou adventices qui peuvent être des hôtes du flétrissement bactérien. Le flétrissement bactérien peut survivre dans le sol et l’eau sans hôte pendant plusieurs années. Par conséquent, la rotation n’est pas efficace contre le flétrissement bactérien. Les tubercules infectés ne doivent pas être stockés ou utilisés comme semences, car la maladie se propagera rapidement à des températures plus chaudes dans les zones de stockage et provoquera la pourriture des tubercules.
Gestion
À ce jour, aucun produit biologique de protection des plantes pour lutter contre le flétrissement bactérien n’est disponible. Par conséquent, la maladie doit être gérée par des pratiques culturales. Un élément essentiel est la prévention de l’apparition de maladies dans une exploitation agricole. Cela comprend (i) l’utilisation de semences saines (certifiées) seulement, (ii) l’utilisation de variétés résistantes lorsqu’elles sont disponibles, (iii) le maintien d’une bonne rotation des cultures avec des plantes autres que les solanacées, (iv) l’épandage régulier de compost sur le sol.
Si un flétrissement bactérien est observé sur un champ, il faut prévenir le développement et la propagation de la maladie dans le champ : i) l’élimination et le brûlage soigneux des plantes et tubercules infestés afin de réduire la propagation de la maladie d’une plante à l’autre, ii) l’épandage de chaux dolomitique autour des plantes infectées pour augmenter le pH du sol ; (iii) aucune culture de pommes de terre ou d’autres solanacées sur ces champs pendant plusieurs années (dans les cas graves depuis plus de 10 ans), (iii) car le flétrissement bactérien se propage rapidement dans les champs très humides, éviter d’arroser le champ ou essayer de faire en sorte que l’eau ne coule pas sur la surface infestée du champ en creusant des canaux qui permettent à l’eau de circuler autour du champ, (iv) ne pas utiliser d’eau contaminée par le flétrissement bactérien pour irriguer la culture, (v) désinfecter les outils agricoles après l’usage.
Bien que la rotation des cultures ne soit pas suffisante pour lutter contre le flétrissement bactérien, l’incidence de la maladie peut être réduite si la culture de cultures non sensibles comme les céréales est combinée à d’autres mesures de lutte.
Plus tôt les infections bactériennes sont détectées, mieux c’est. Par conséquent, il est recommandé d’observer les pommes de terre (et autres cultures de solanacées) à la recherche de symptômes de flétrissement bactérien à partir de 35 jours.
Jambe noire et pourriture bactérienne molle dans les tubercules
La maladie de la jambe noire de la pomme de terre est causée par plusieurs espèces de bactéries qui sont transmises par les tubercules (Dickeya ssp., Pectobacter ssp et autres). La maladie peut entraîner de graves pertes économiques pour la culture de pommes de terre. Cependant, la présence de jambe noire dépend beaucoup des conditions de croissance, en particulier de la température et des précipitations après la plantation. Comme la maladie de la jambe noire est aussi une maladie bactérienne, tout comme le flétrissement bactérien, les symptômes, le cycle de vie et la prise en charge sont similaires (pour plus d’informations, voir chapitre 2.10.1.2).
Symptômes
La jambe noire précoce se développe peu après l’émergence des plantes. Le feuillage est rabougri et jaunâtre et a un aspect rigide et dressé. La tige inférieure est brun foncé à noir et largement décomposée. Les jeunes plants infestés ne se développent pas davantage et meurent.
La jambe noire peut aussi se développer plus tard dans la saison de croissance. Le premier symptôme est une décoloration noire des tiges souterraines, suivie d’un flétrissement et d’un jaunissement rapide des feuilles. Les tiges entièrement malades se décomposent, se dessèchent et sont souvent perdues de vue.
Source et propagation
Les bactéries se propagent principalement par les tubercules de semence. La pourriture molle se forme lorsque les conditions de croissance des bactéries sont optimales avec suffisamment d’eau et que la résistance du tubercule peut être surmontée. Les tubercules sains sont rarement infestés. Au moment de l’entreposage, l’infection dormante peut se propager après que les tubercules ont été lavés ou sont entreposés dans des sacs de plastique (en raison des conditions chaudes et humides).
Les bactéries se développent dans des conditions plus fraîches et humides. L’infection est favorisée par la pourriture sèche fusarienne, les dommages causés aux tubercules par les mille-pattes, la teigne des tubercules, les outils, les impacts ou un sol saturé d’eau.
La maladie peut être contrôlée par une bonne hygiène. Les mesures de lutte, qui réduisent la contamination bactérienne sur les tubercules de semence, réduisent également le risque de pourriture molle et de jambe noire.
Gestion
Les mesures de prévention comprennent (i) l’utilisation de semences saines, (ii) la promotion de l’émergence rapide, (iii) la prévention du mildiou des tubercules, (iv) éviter la saturation du sol avec l’eau et l’irrigation excessive, (v) maintenir des rotations de cultures appropriées avec des intervalles recommandés entre les solanacées.
Récolter la culture le plus tôt possible, lorsque les tubercules ont développé une peau ferme, limite le risque de propagation. Lors de la récolte, les dommages mécaniques doivent être évités. Les pommes de terre doivent être complètement sèches avant le stockage. Pour cela, les pommes de terre sont laissées à l’air libre quelques jours avant le stockage. Les tubercules ne doivent être entreposés que dans un endroit sec. La transpiration et la condensation de l’humidité pendant le stockage et le transport doivent être évitées, car cela favorise la germination des spores. Pour la ventilation, il faut utiliser de l’air sec.
En cas d’infection, la propagation de la maladie dans des champs sains doit être évitée en n’utilisant que des machines propres. Les tubercules infestés doivent être commercialisés non lavés.
Maladies virales
Une réduction du rendement des pommes de terre peut être due à une faible fertilité du sol et à une nutrition insuffisante des plantes. Cependant, elle peut aussi être due à une infection virale. La pomme de terre est affectée par différents virus, l’un d’entre eux étant le Virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV). Les symptômes sur les plantes après l’infection varient selon le virus, allant de la marbrure des feuilles à l’aspect mosaïque des feuilles et du froissement à la croissance naine. Les plantes fortement infectées donneront une mauvaise récolte de petits tubercules. Dans les infections bénignes, les plantes ne montrent souvent aucun signe de maladie. Par conséquent, les infections virales sont sous-estimées par la plupart des agriculteurs parce que les virus ne sont pas visibles à l’œil nu et que les plantes meurent rarement.
Les virus sont transmis par les pucerons et autres insectes suceurs comme les thrips, les acariens et les aleurodes, ainsi que par des tubercules infestés. Les pucerons propagent la maladie dans le champ et d’un champ à l’autre. La transmission mécanique par des outils est également possible, mais secondaire par rapport à la transmission par les pucerons. Certains virus, comme le virus PLRV, infectent également d’autres cultures de solanacées et des mauvaises herbes comme la tomate, le tabac et la mauvaise herbe pomme-épineuse (Datura stramonium).
Souvent, l’infection virale est due à la réutilisation continue de matériel de plantation propre à la ferme, transférant l’infection d’une culture à l’autre avec des tubercules de semence infestés. Lorsque les agriculteurs sélectionnent les tubercules les plus petits pour les semences, et que les tubercules choisis sont ceux qui sont déjà infectés par des maladies virales (conduisant à des tubercules plus petits), le risque de transmission des pathogènes est accru.
Comme les symptômes apparaissent aux premiers stades de la croissance de la pomme de terre, les observations devraient commencer lorsque les plantes se lèvent, en marchant le long des lits de semis surélevés et en cherchant des plantes présentant des symptômes de la maladie.
Les principes de gestion sont presque les mêmes pour toutes les maladies virales. Les virus peuvent être contrôlés par (i) l’utilisation de tubercules de semence exempts de virus ; (ii) l’utilisation de variétés résistantes lorsqu’elles sont disponibles ; (iii) le déracinement des plantes infectées pour réduire la propagation de la maladie dans le champ et leur destruction. L’efficacité maximale est obtenue en enlevant toutes les plantes dans un rayon de 1 m autour de la plante malade. Ceci est particulièrement important dans les champs de semences. Contrôler les solanacées et les pommes de terre spontanées dans ses propres champs et dans les champs voisins, car ces plantes peuvent être des réservoirs pour le pathogène ; (iv) éviter la superposition des cultures de pommes de terre ; et (v) contrôler les insectes suceurs comme principaux vecteurs des virus.
Teigne de la pomme de terre
La teigne de la pomme de terre (Phthorimea opercullella) est le ravageur le plus grave de la pomme de terre en Afrique. Le petit papillon est présent partout où l’on cultive des pommes de terre. Outre la pomme de terre, l’insecte s’attaque aussi aux tomates et autres solanacées. Les dégâts sont causés par les larves de la teigne (chenilles) qui creusent des tunnels dans les tubercules de pomme de terre.
Les femelles sont actives après le coucher du soleil et au crépuscule et pondent des œufs sur les endroits abrités des feuilles et des tiges des plants de pomme de terre et près des bourgeons oculaires des tubercules exposés par des fissures dans le sol ou dans le dépôt. Les mites pondent aussi des œufs sur les bourgeons de pomme de terre pendant la pré-germination et sur les sacs avec des tubercules de pomme de terre dans le magasin. Une femelle pond jusqu’à 200 œufs.
Lorsque les chenilles blanchâtres à vert pâle éclosent des œufs après 8 jours, elles se nourrissent sous la couche supérieure de la peau des feuilles et des tiges et se frayent un chemin jusqu’aux tubercules, où elles creusent de longs tunnels noirs irréguliers remplis d’excréments. Les chenilles issues d’œufs pondus sur des tubercules commencent à se nourrir de tubercules dès l’éclosion. Dans les tunnels d’alimentation, des champignons pathogènes, des bactéries et des acariens se développent. Les tubercules commencent à pourrir et développent une odeur désagréable. Les tubercules infestés ne peuvent plus être utilisés pour la consommation humaine.
Lorsque les chenilles de 15 mm de large ont suffisamment mangé après environ 2 semaines, elles se nymphosent dans un cocon recouvert de particules de sol et de débris parmi les feuilles de pomme de terre mortes, la litière de sol, les yeux des tubercules. Au dépot, les nymphes se trouvent entre les tubercules, à l’entrée des tunnels larvaires et sur les murs et les sols de la salle de stockage.
Au moment de la récolte, le ravageur est transféré avec les tubercules du champ au dépôt, où il peut se reproduire et infester d’autres tubercules. Les tubercules infestés entreposés peuvent entraîner la destruction de toute la récolte au moment de l’entreposage. Entre les cultures de pommes de terre, le ravageur survit sous forme de nymphes dans le sol ou dans les pommes de terre abandonnées laissées dans le champ au moment de la récolte.
Les tubercules sont attaqués lorsqu’ils deviennent plus gros et s’approchent de la surface du sol. À ce moment, le sol se fend et les larves quittent le feuillage pour attaquer les tubercules et pondre des œufs sur eux ou à proximité. Les infestations sont pires dans les sols lourds qui se fissurent lorsqu’ils sont secs.
Le papillon adulte mesure de 8 à 10 mm de long. Les mâles ont des ailes marron avec des franges et des taches foncées, les femelles ont un motif en X lorsque les ailes sont ensemble. Les papillons vivent jusqu’à 10 jours.
Prévention
La prévention des dommages causés par la teigne des pommes de terre comprend (i) l’utilisation de semences saines et propres, puisque les tubercules infestés sont la principale cause de ré-infestation dans le champ ; (ii) éviter de planter dans un sol rugueux et un sol trop léger et meuble, car cela facilite l’exposition des tubercules ; (iii) planter à au moins 10 cm de profondeur ; (iv) former des buttes compactes au moins trois fois pendant la culture, ce qui crée des buttes compactes. Des crêtes compactes empêchent les papillons de nuit d’atteindre les tubercules pour pondre des œufs, et les papillons de nuit sortant des tubercules infestés pour s’envoler. (vi) cibler une récolte précoce pour éviter une infestation tardive et récolter les tubercules dès qu’ils sont prêts, car les tubercules laissés dans le champ pendant une plus longue période sont fortement infestés. vii) Au moment de la récolte, s’assurer que les tubercules ne sont pas exposés aux papillons de nuit avant qu’ils ne soient correctement protégés dans l’entrepôt. Tous les tubercules récoltés doivent être entreposés convenablement avant la fin de l’après-midi ; viii) trier soigneusement les tubercules avant l’entreposage, enlever tous les tubercules avec ouvertures ou galeries et détruire immédiatement toutes les pommes de terre infestées ; ix) décontaminer soigneusement les salles d’entreposage avant d’entreposer les nouveaux tubercules de pommes de terre ; x) enlever tous les tubercules et résidus végétaux restants du champ et détruire tous les plants spontanés de pommes de terre avant de planter de nouvelles pommes de terre ; xi) En cas de forte infestation, la rotation des cultures devrait être prolongée jusqu’à 5 ans.
La coccinelle, la chrysope et les guêpes parasites sont des ennemis naturels importants de la pyrale de la pomme de terre. Les coccinelles s’attaquent aux œufs et aux jeunes chenilles. Les larves de chrysopes, de punaises prédatrices, de carabes, de perce-oreilles et forficules s’attaquent à tous les stades du ravageur. Les ennemis naturels peuvent être promus par la promotion de plantes florales indigènes qui fournissent de la nourriture et un abri aux insectes. Plusieurs guêpes parasites, originaires d’Amérique du Sud, ont été introduites dans plusieurs pays d’Afrique et ont permis de lutter efficacement contre les ravageurs.
Protection
La culture associée de pommes de terre avec du piment fort, des oignons ou des petits pois éloigne les mites dans une certaine mesure. Le paillage des buttes avec des feuilles de neem au cours des 4 dernières semaines avant la récolte peut réduire considérablement les dommages causés par les insectes.
Le traitement des plants de pomme de terre avec du neem pendant la culture limite la prolifération du ravageur.
Lors du stockage, le stockage des pommes de terre en couches avec des branches de lantana (Lantana aculeate) ou Eucalyptus globulus assure une certaine protection des tubercules. L’infestation de tubercules peut être réduite en plaçant les pommes de terre dans les feuilles du poivrier péruvien (Schinus molle). Les tubercules peuvent également être vaporisés avec de l’extrait de graines de neem avec 1 kg d’extrait de neem dans 40 l d’eau avant d’être emballés dans des sacs. Alternativement, la poudre de Bt (Bacillus thuringiensis) mélangée à du sable fin (1:25) saupoudré contrôle également le ravageur dans le dépôt. L’application d’une grande quantité de cendres de bois ou de terre de diatomite sur les plantes empêche l’accumulation rapide de la teigne des tubercules. Des pièges à phéromones peuvent être placés dans le local de stockage pour perturber les mites.
Exchange of experience
Demandez aux agriculteurs quels sont les ravageurs et les maladies qu'ils connaissent et qui causent des dégâts dans leurs champs. Comment les reconnaissent-ils ? Que savent-ils de leurs cycles, des conditions de propagation et des mesures de lutte préventive et directe ?
Essayez de clarifier les questions suivantes relatives aux maladies :
- Quelle est la cause de la maladie : est-ce un virus, une bactérie ou un champignon ?
- Comment se transmet-elle : par les graines, par le sol, par l'air ou par les insectes ?
- À quel stade de la plante s'attaque-t-elle : le semis, la plante en croissance ou la plante mature ?
- Quelle partie de la plante est infestée : les feuilles, les racines, la tige, les fruits, les graines ou la plante entière ?
- Quel type de dégâts provoque-t-il : pourriture, chlorose, flétrissement, taches ou autres ?
- Quand attaque-t-il : pendant la saison sèche ou pendant la saison humide ?
Essayez de répondre aux questions suivantes concernant les parasites :
- A quel stade de son cycle de vie l'agent pathogène est-il un ravageur : quand il est une larve, une chenille ou un adulte ?
- A quel stade de la plante s'attaque-t-il : la plantule, la plante en croissance ou la plante mature ?
- Quelle partie de la plante attaque-t-il : les feuilles, les racines, la tige, les fruits, les graines ou la plante entière ?
- Quels sont les dégâts qu'il provoque : mastication, succion ou flétrissement ?
- Quand attaque-t-il : en saison sèche ou en saison humide ?
Défanage et récolte des pommes de terre
Le travail de récolte consiste à détruire les parties aériennes (ce qu’on appelle le défanage), à lever et à ramasser les tubercules. Le moment de la récolte des pommes de terre varie selon le cultivar, le climat, la maladie et la pression des ravageurs, et peut-être même du prix. Des conditions de sol inégales et le mildiou dans une culture entraînent souvent une maturation inégale des tubercules. Le défanage au bon moment favorise une maturation plus régulière et précoce ainsi qu’une maturation précoce de la peau. Les pommes de terre de semence sont récoltées tôt, entre 80 et 100 jours après la plantation, selon la variété, afin d’éviter des infections virales qui peuvent survenir dans la deuxième moitié de la saison de croissance. Les maladies virales, en particulier, se propagent aux tubercules si les tiges commencent à flétrir et à se sécher. Il en va de même pour d’autres maladies comme le mildiou, la pourriture du collet et le flétrissement bactérien.
Une récolte trop précoce peut conduire à des pommes de terre non mûres et non stockables avec une teneur en amidon trop faible et une repousse des feuilles. Les tubercules de pomme de terre immatures ont une peau mince et peu développée et sont facilement abîmés. Cela peut entraîner une infection plus facile par des champignons et des bactéries. Les tubercules immatures ont également tendance à avoir une faible teneur en matière sèche et sont très périssables et ne peuvent être stockés que pour une courte période.
L’attaque du mildiou est la raison la plus courante pour une récolte précoce afin de réduire le risque de mildiou des tubercules. Si la période de croissance des plants de pommes de terre sains est prolongée, la destruction tardive du foin peut entraîner une teneur en amidon plus élevée, de meilleures propriétés de cuisson et une meilleure saveur.
Défanage
La culture est prête pour le défanage, lorsque les tubercules ont atteint leur taille préférée pour la commercialisation ou si l’on ne s’attend pas à une croissance supplémentaire du rendement commercialisable. Lors du défanage, les plantes sont coupées manuellement ou mécaniquement à la base de leurs tiges. Si le feuillage est sain, il peut être collecté et composté. Les feuilles présentant des symptômes de la maladie doivent être brûlées ou compostées de façon adéquate, avec des retournements fréquents et des périodes de chaleur complètes dans la pile pour tuer la maladie. Après le défanage, on donne aux tubercules 14 à 21 jours pour développer une peau mature et ferme. Les tubercules bien mûrs sont moins sensibles aux dommages et à la pourriture au stockage. Les tubercules sont matures, lorsque les peaux sont fermes et ne peuvent pas être enlevées en frottant légèrement les tubercules avec les doigts.
Récolte
Une peau stable des tubercules est la condition de base pour définir l’état de préparation à la récolte. A ce stade, la récolte ne devrait pas être retardée inutilement, si les conditions météorologiques et les conditions du sol permettent d’arracher les tubercules en toute sécurité. Le retard de la récolte augmente considérablement le risque de détérioration de la qualité causée par les vers fil de fer, les millipèdes et la rhizoctone. D’autre part, la stabilité incomplète de la peau, la pluie ou un sol humide, ou un sol très sec, un nombre élevé de tubercules affectés par la pourriture humide, sont des raisons de retarder la récolte de quelques jours. La récolte nécessite un temps sec et un sol modérément sec. Si les sols sont très secs et motteux, l’irrigation avec 5 à 15 mm d’eau par m2 peut faciliter la récolte.
Dans la plupart des fermes au Cameroun, les pommes de terre sont récoltées manuellement avec des houes à la main. La récolte mécanique n’est pratiquée que dans les grandes exploitations agricoles.
La récolte avec des houes manuelles peut endommager les tubercules, qui doivent être triés et ne peuvent pas être stockés. Il est préférable de laisser les tubercules avec la terre attachée au sol pendant deux heures pour laisser le sol sécher et tomber, car les tubercules avec la terre attachée peuvent les faire pourrir.
La pression et les blessures pendant la récolte, le stockage, le tri, le chargement, le lavage, l’emballage et le transport peuvent endommager les tubercules. Les taches endommagées ne deviendront visibles qu’après quelques jours, lorsque la décoloration aura lieu. Par conséquent, une manipulation soigneuse pendant et après la récolte est essentielle pour assurer une bonne qualité des tubercules.
Les tubercules récoltés doivent être triés par taille et qualité, en séparant les tubercules sains des tubercules endommagés, puis soigneusement placés dans une boîte ou un panier. Les pommes de terre ne doivent pas être jetées à distance.
Après la récolte, le champ doit être nettoyé des parties restantes de la plante et des tubercules pourris. L’assainissement des champs après la récolte est un élément important de la lutte contre les ravageurs et les maladies, car il élimine les sources potentielles de contamination pour la prochaine récolte.
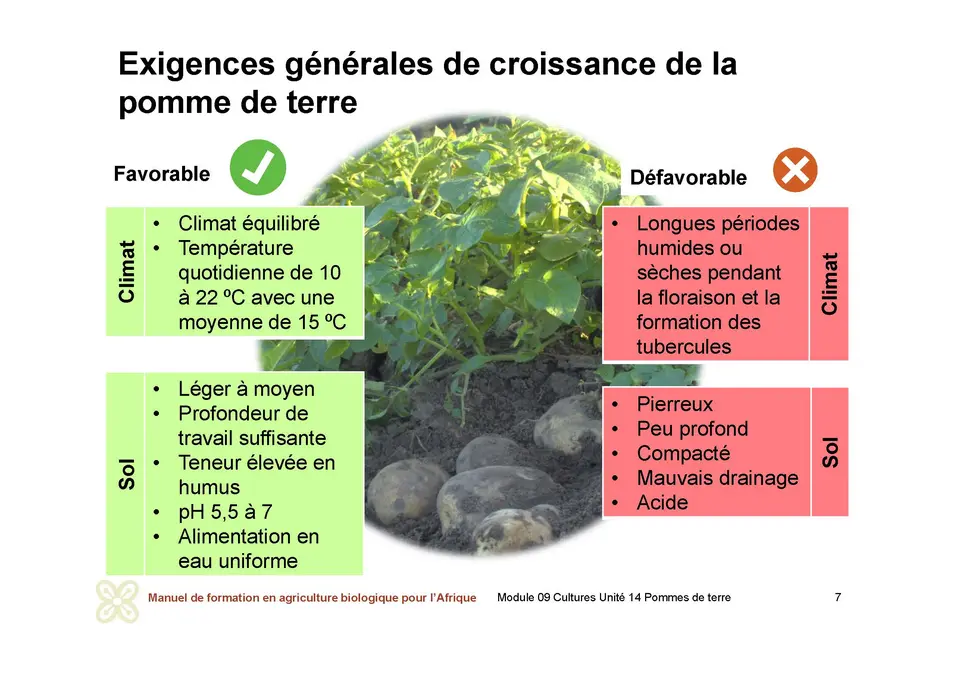

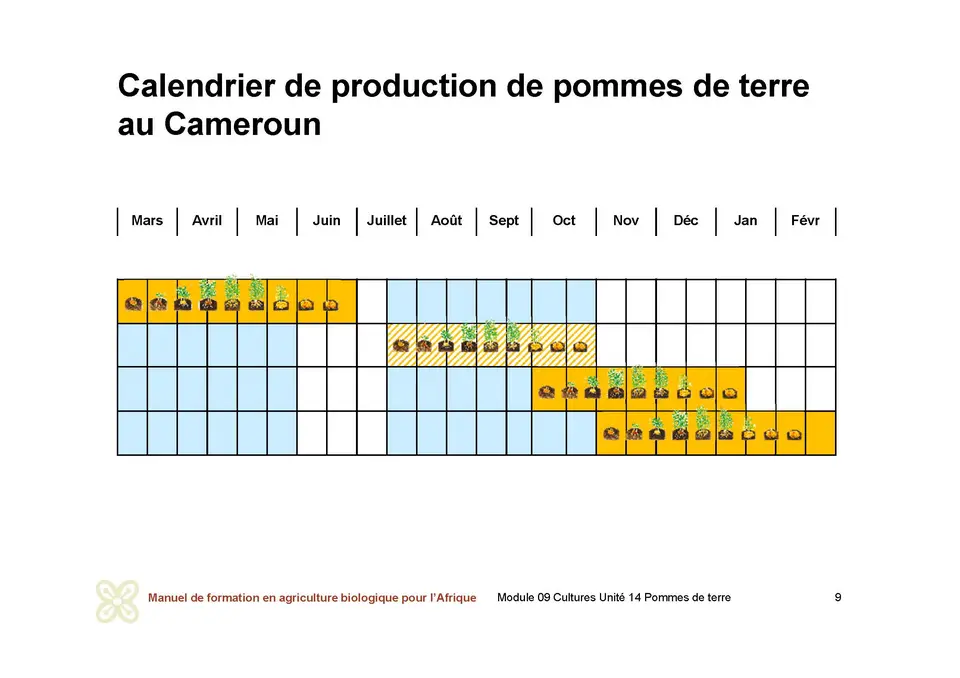
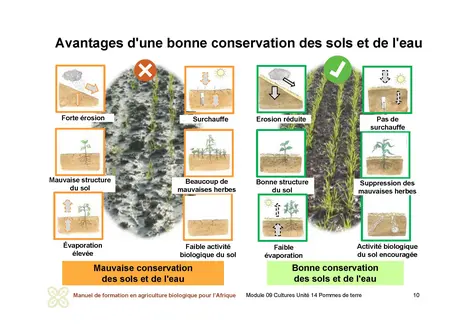
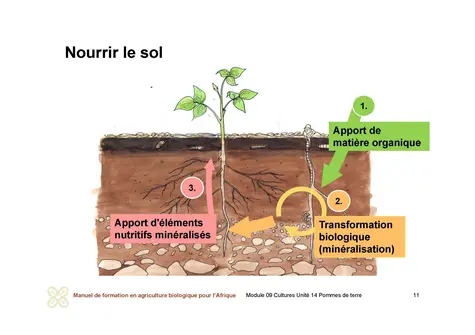

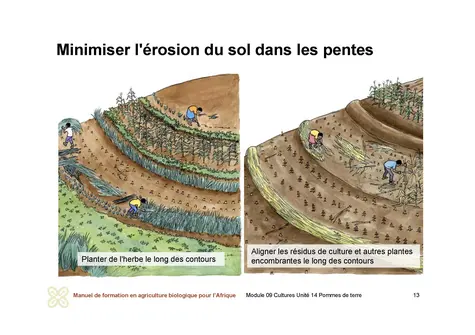
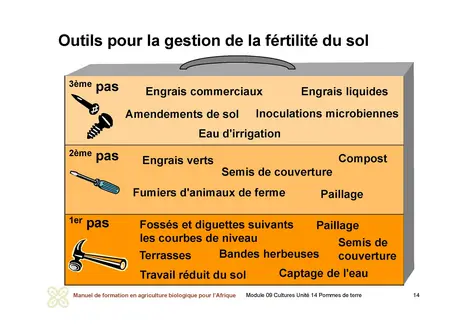
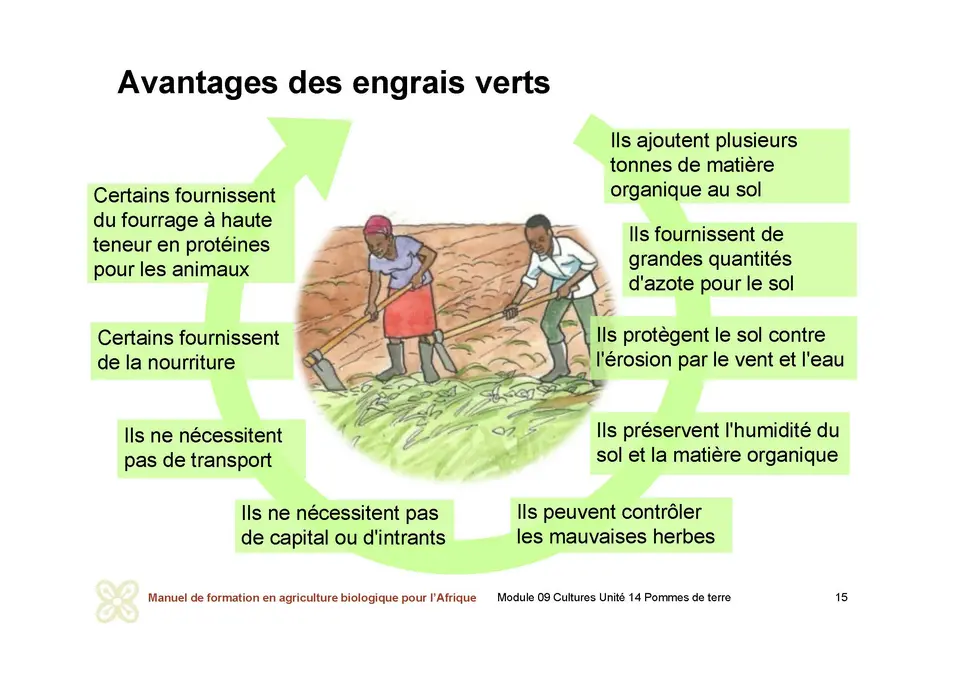
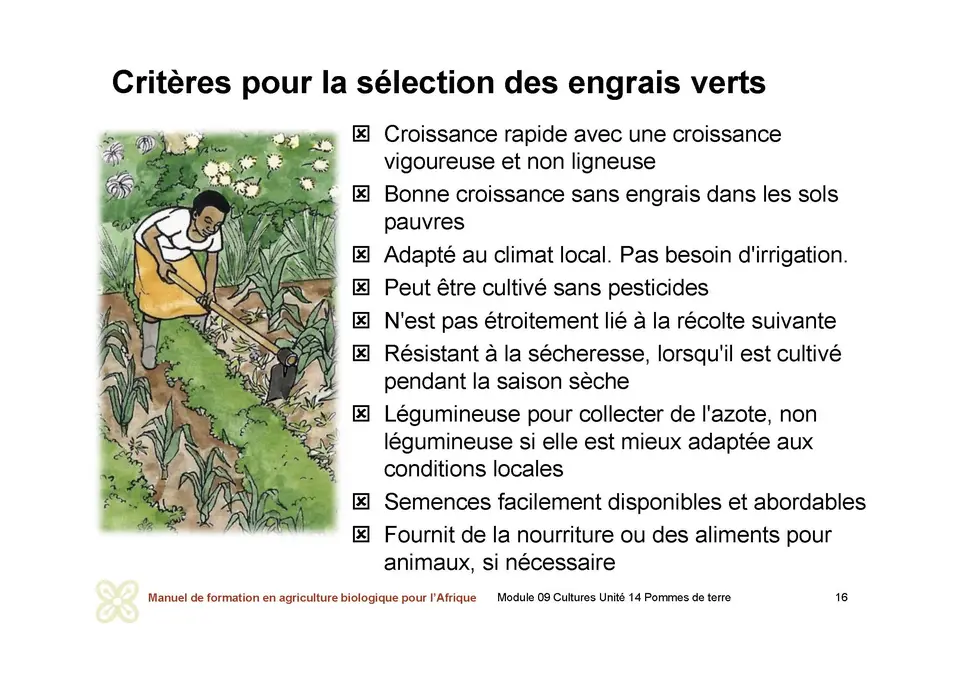
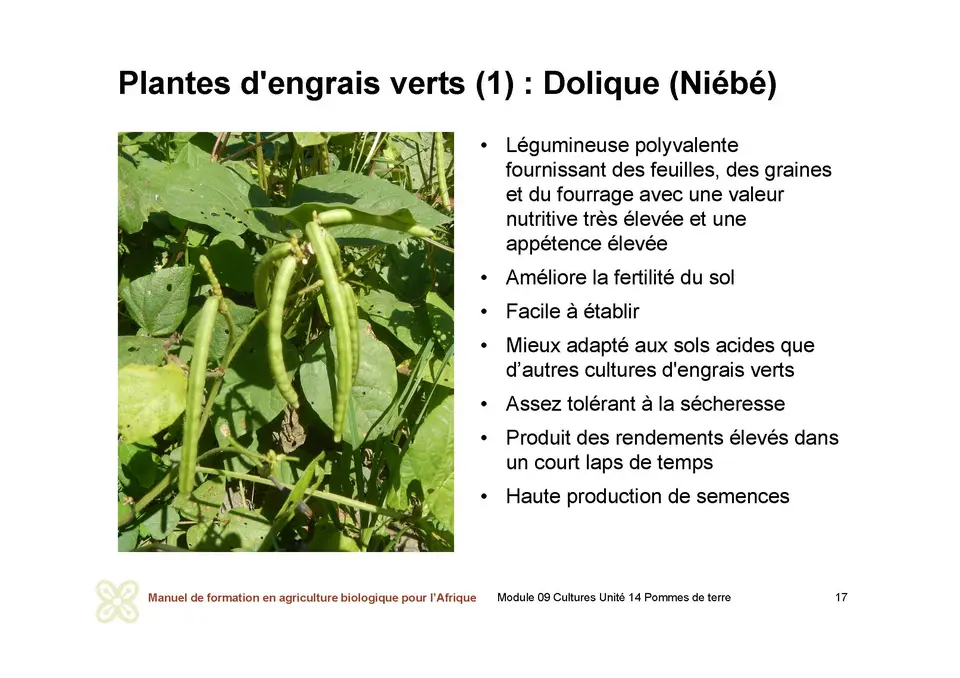
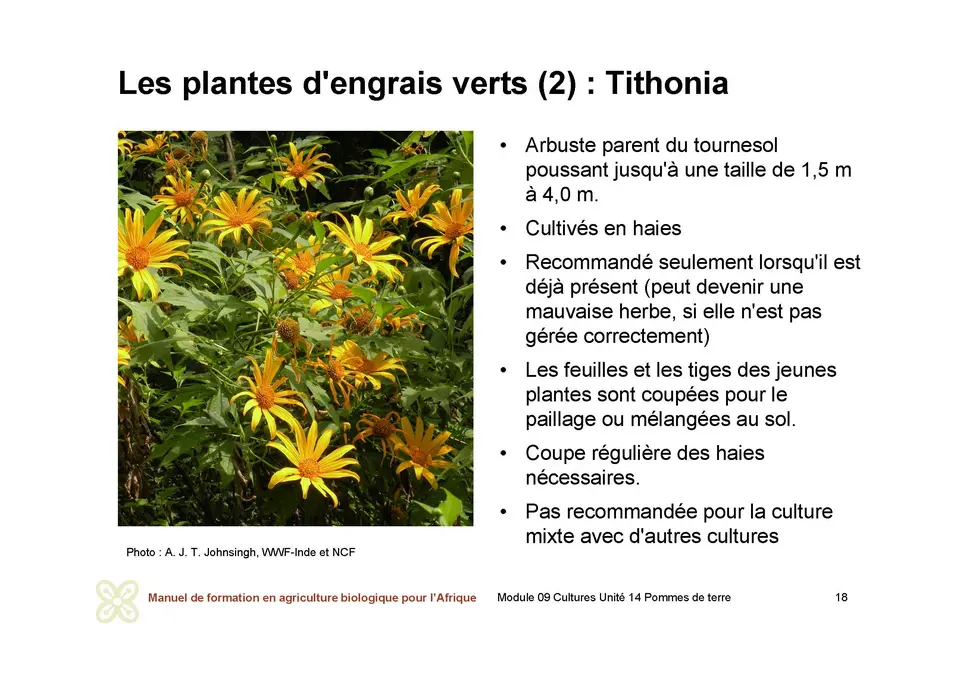

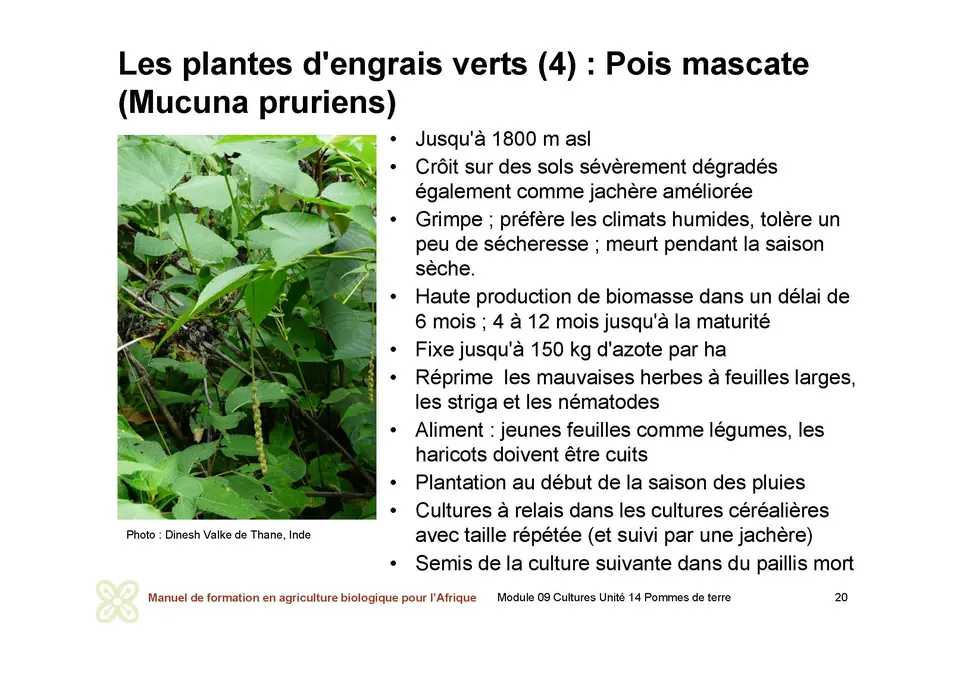
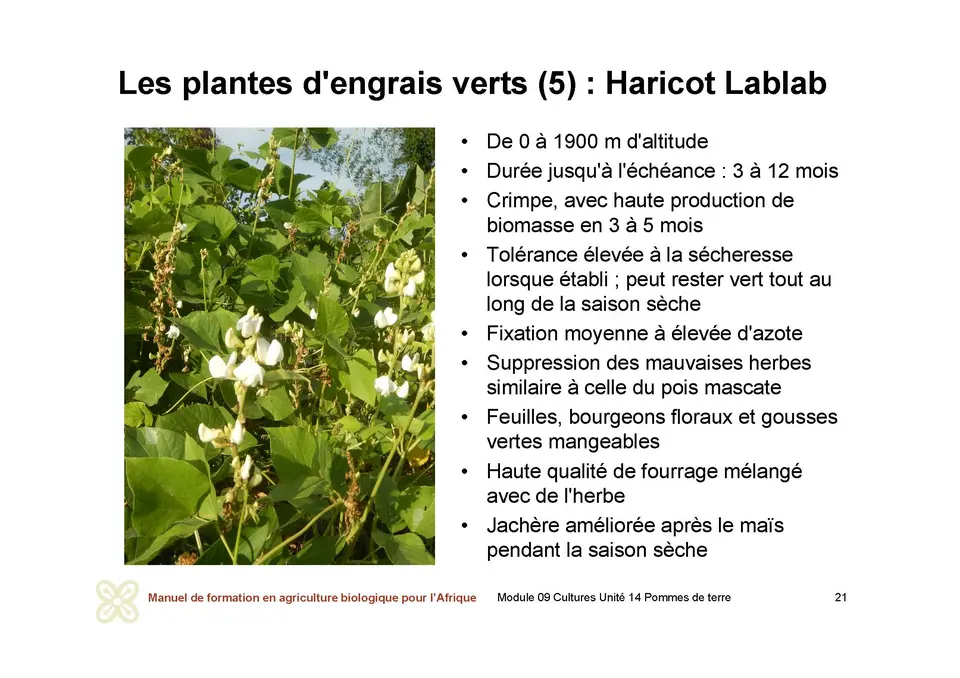
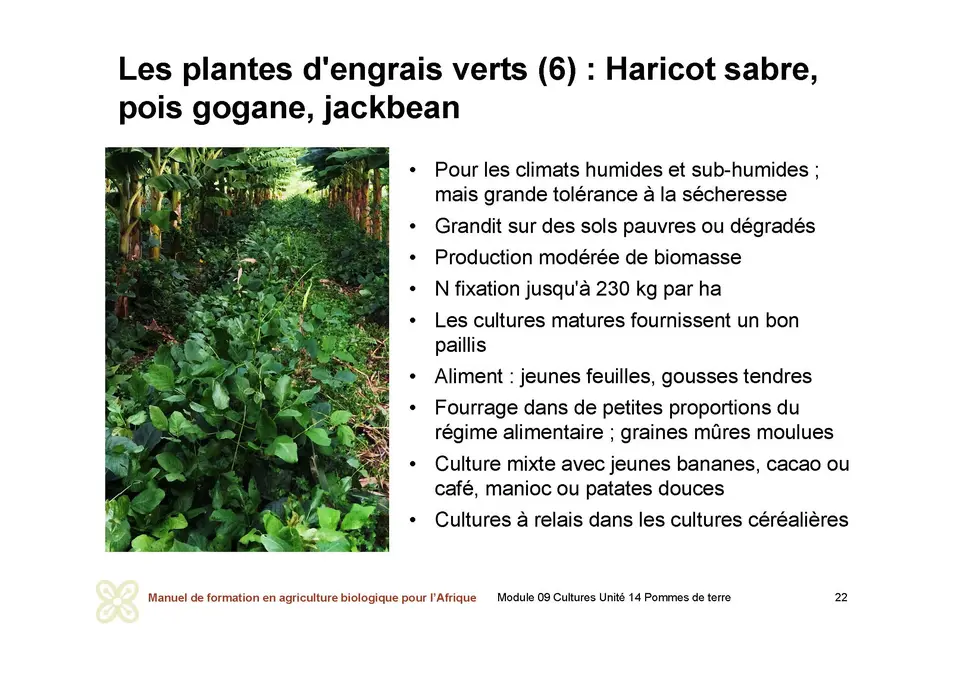
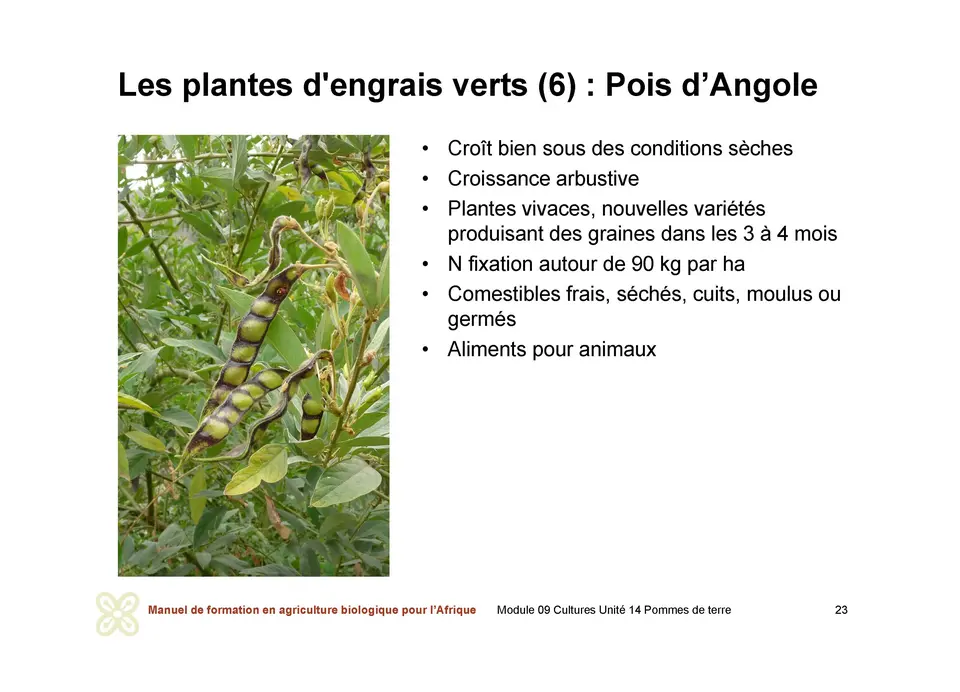
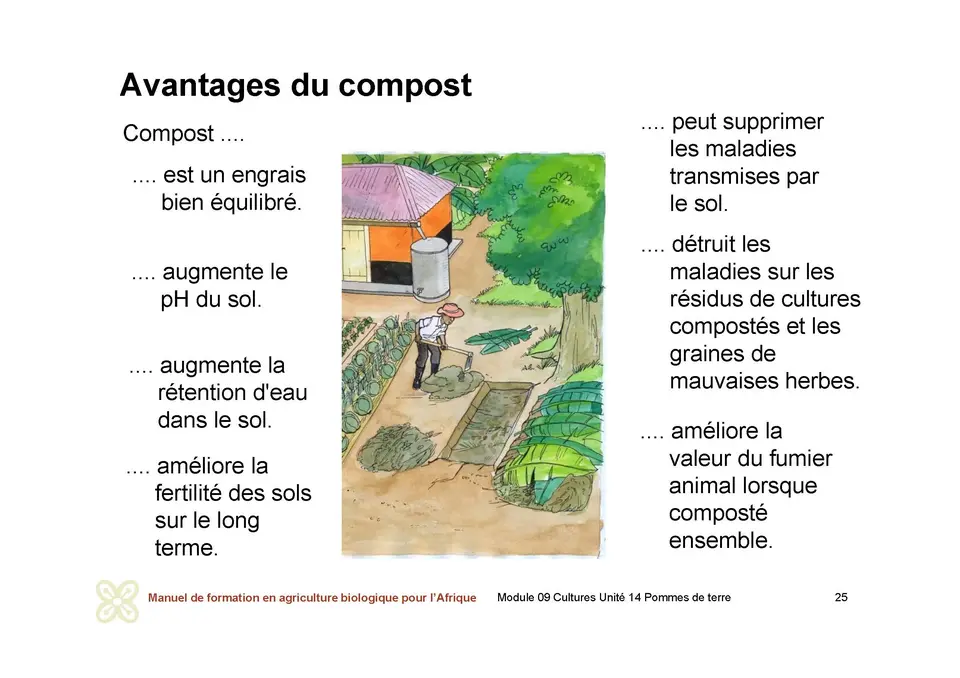
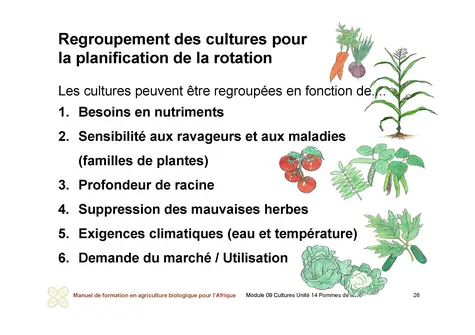
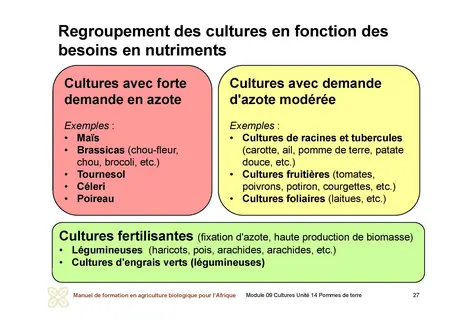
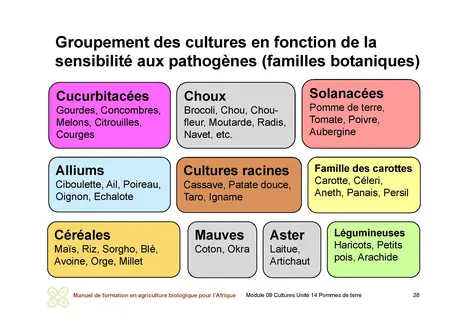
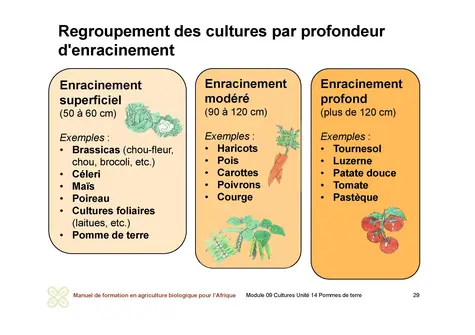
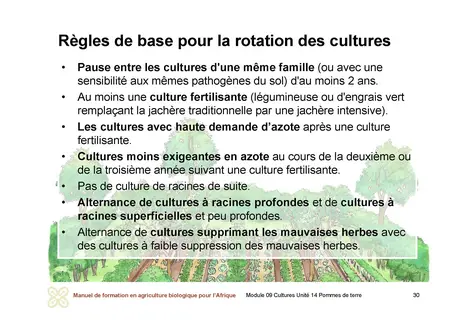
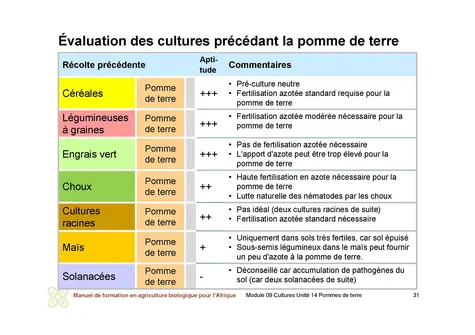
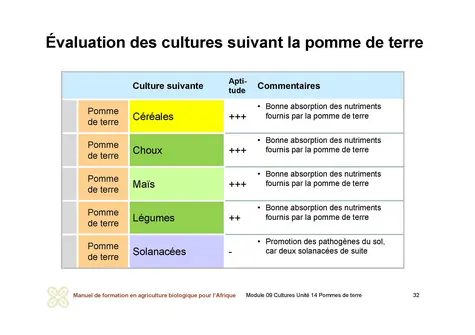
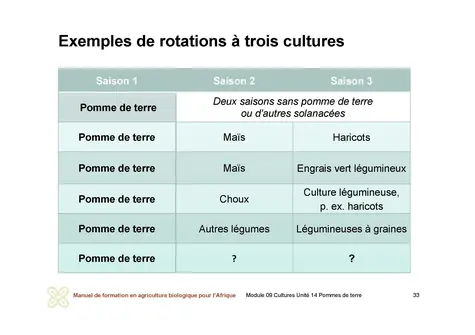
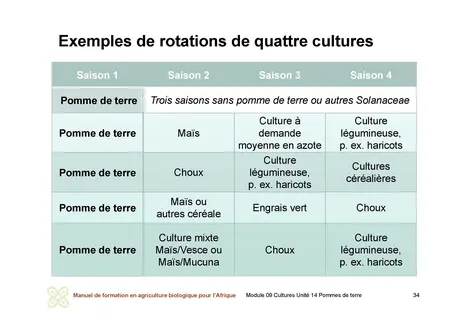

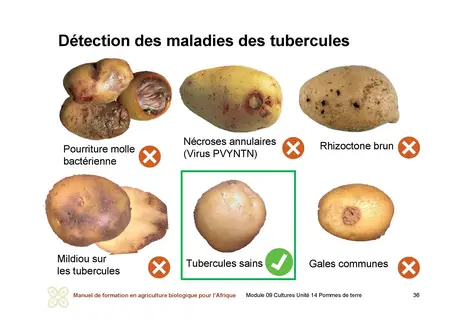
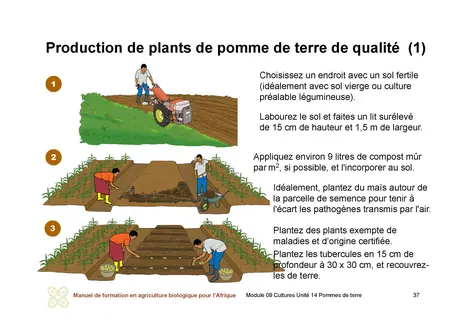
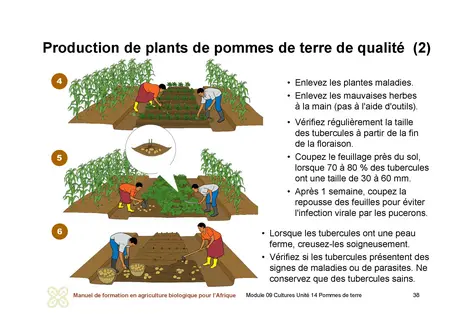
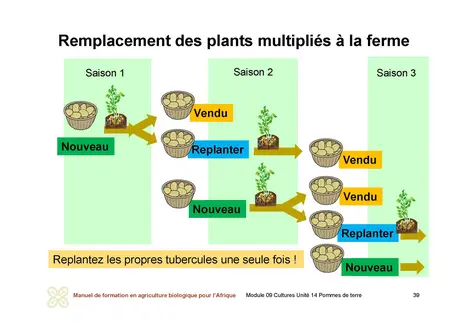
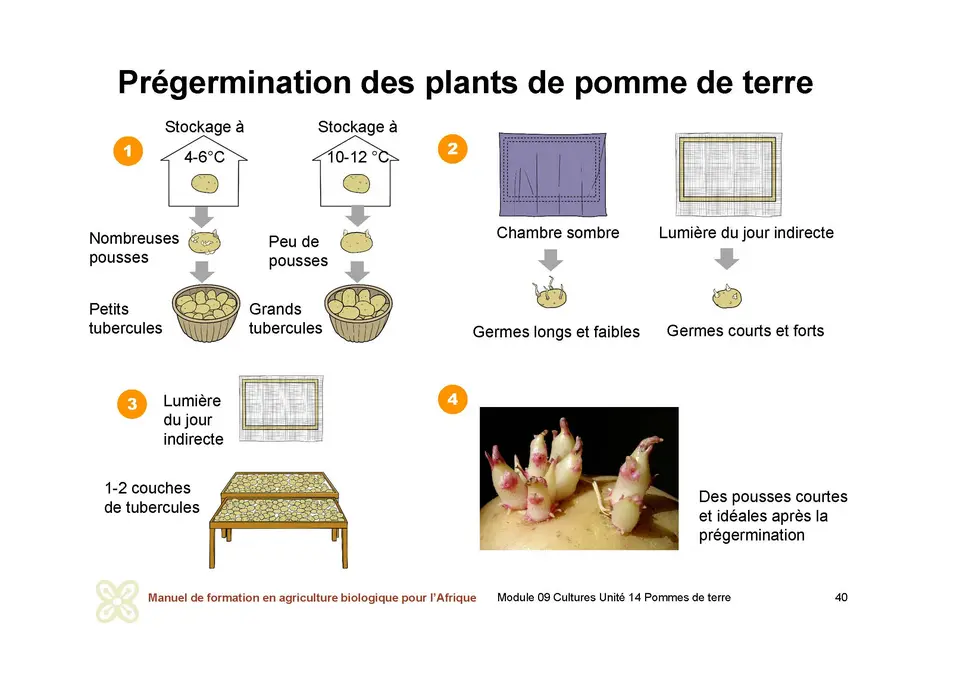
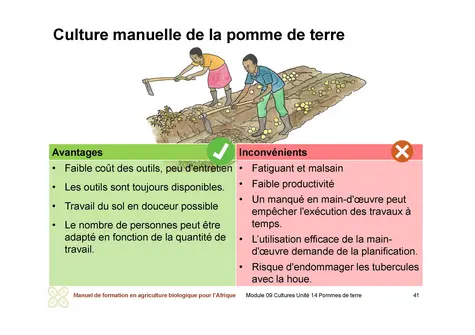
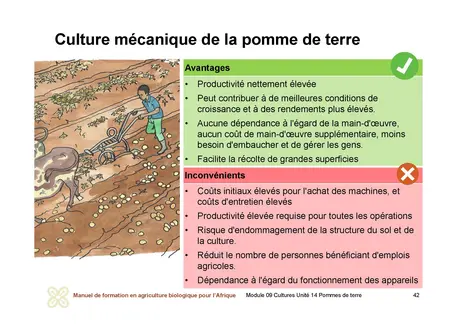
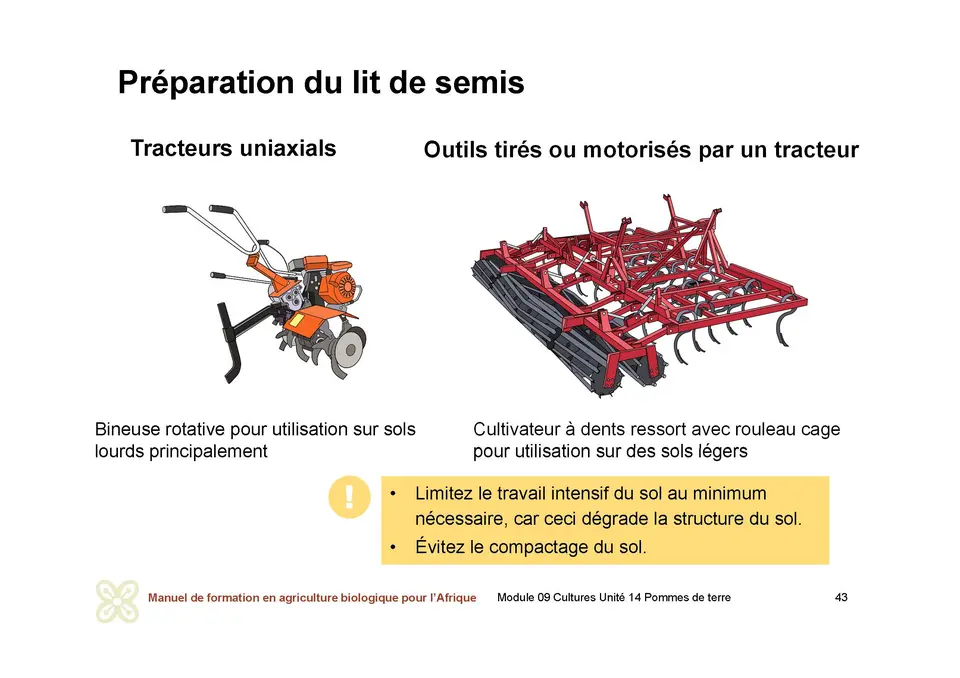
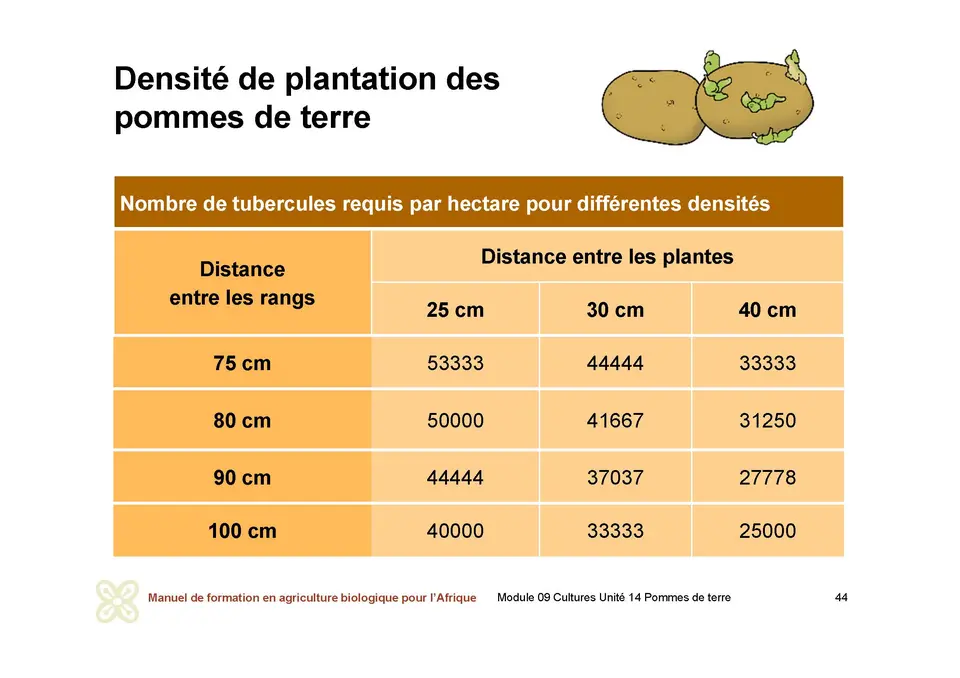
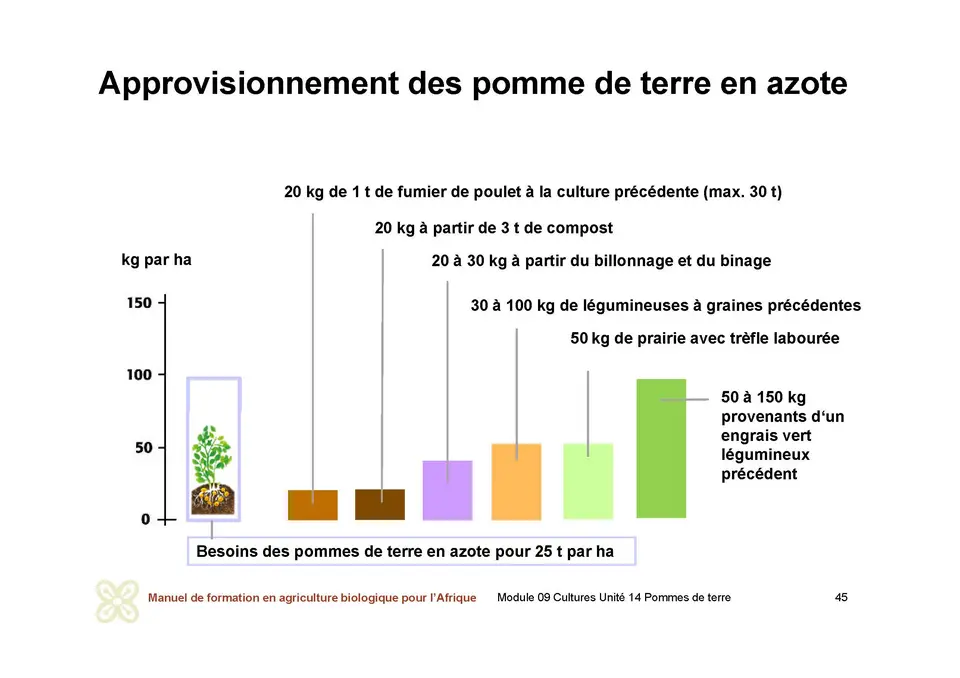
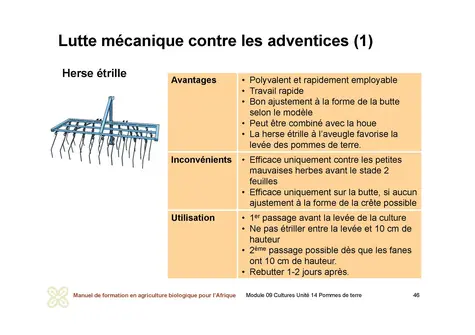
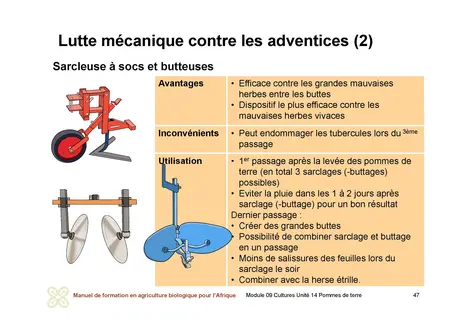
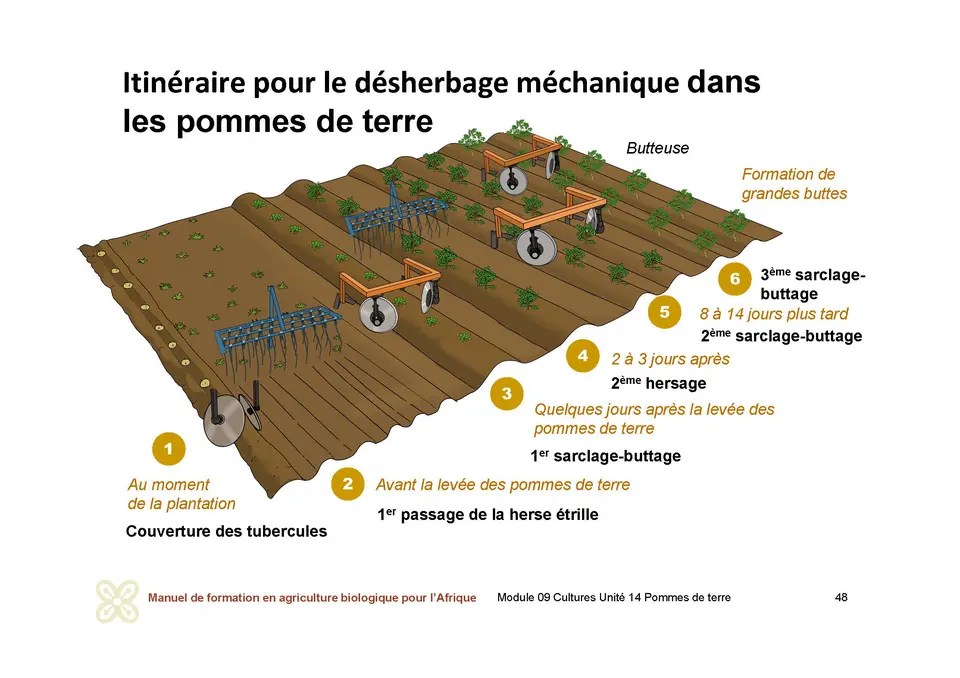
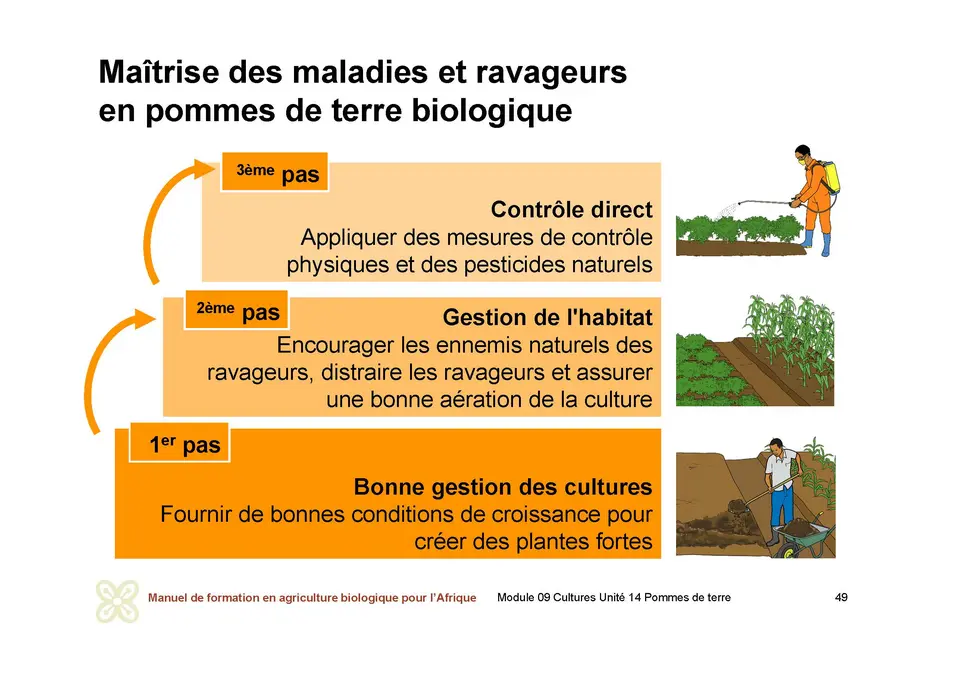
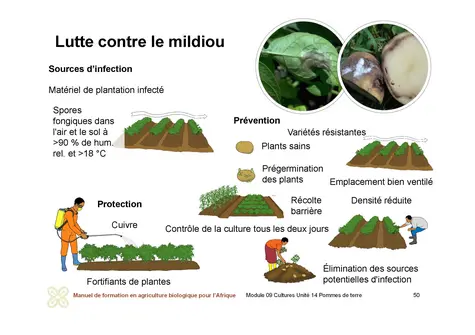
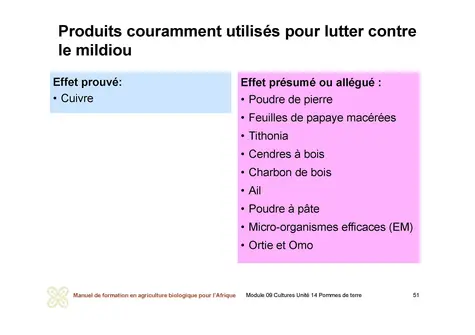
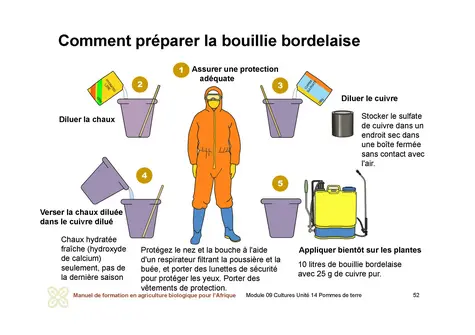
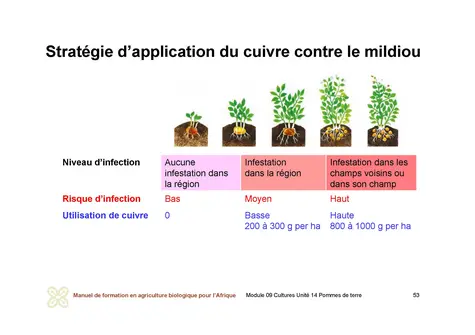
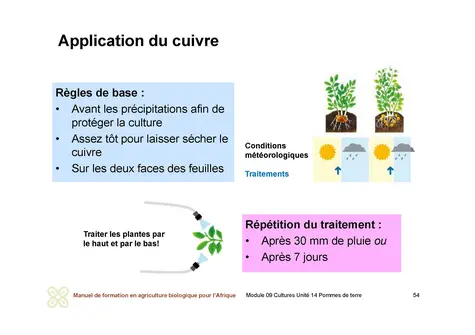
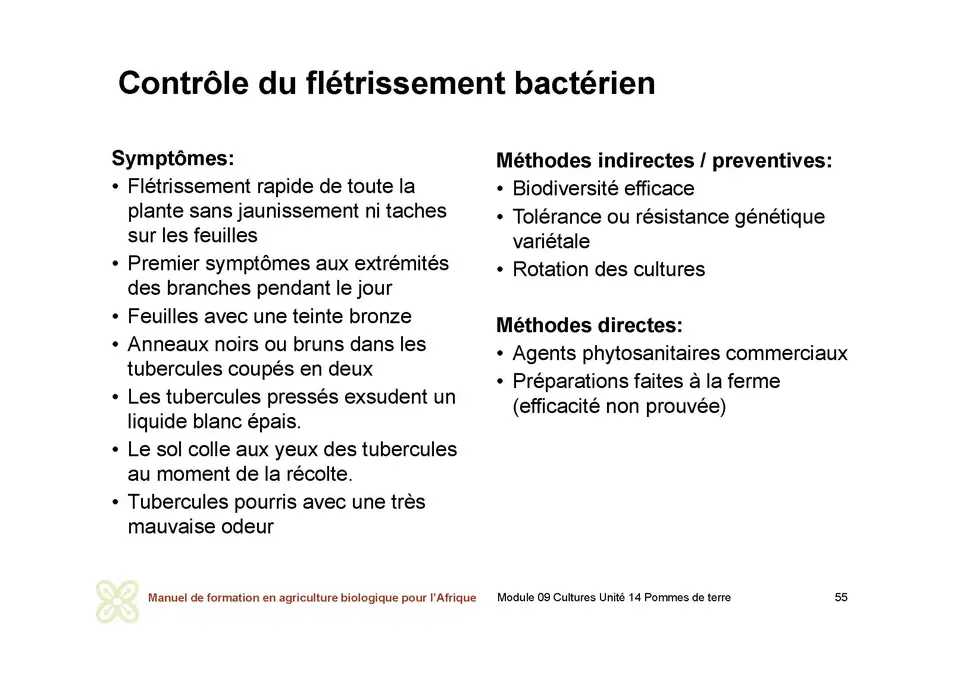
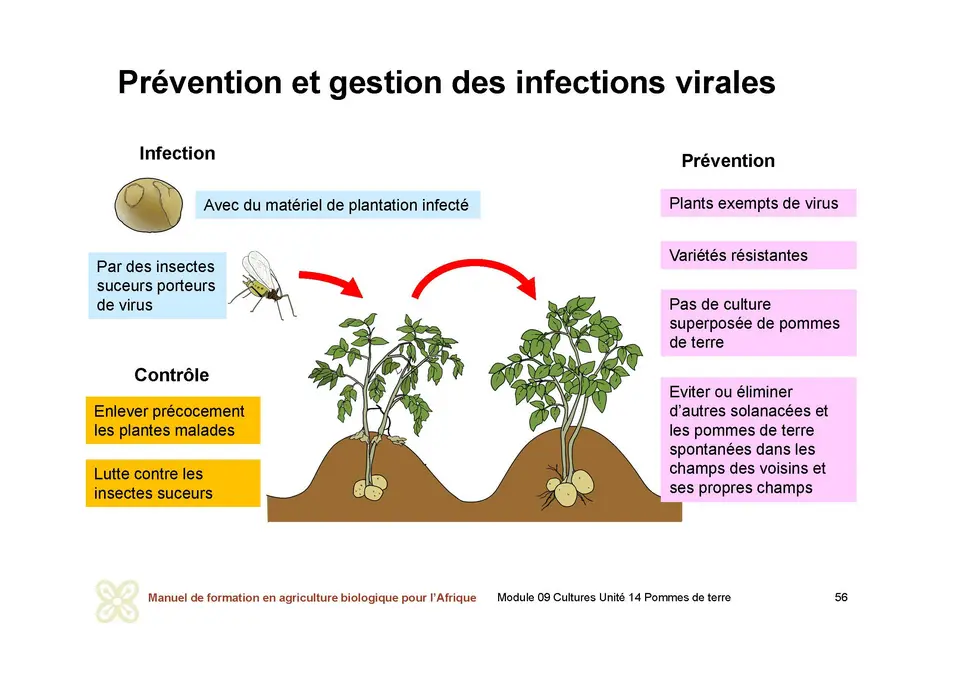
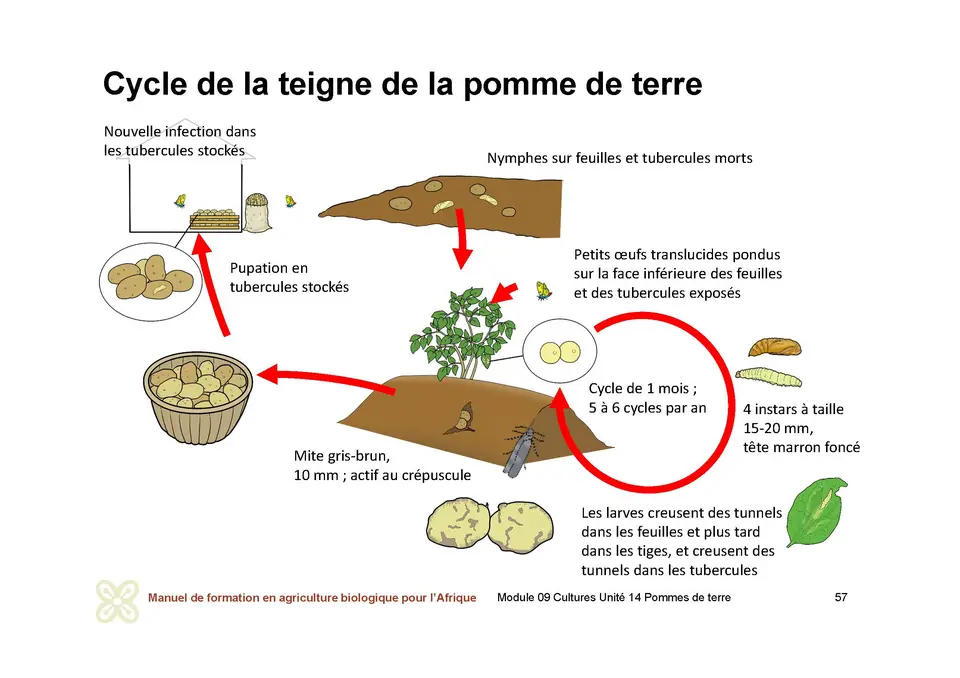
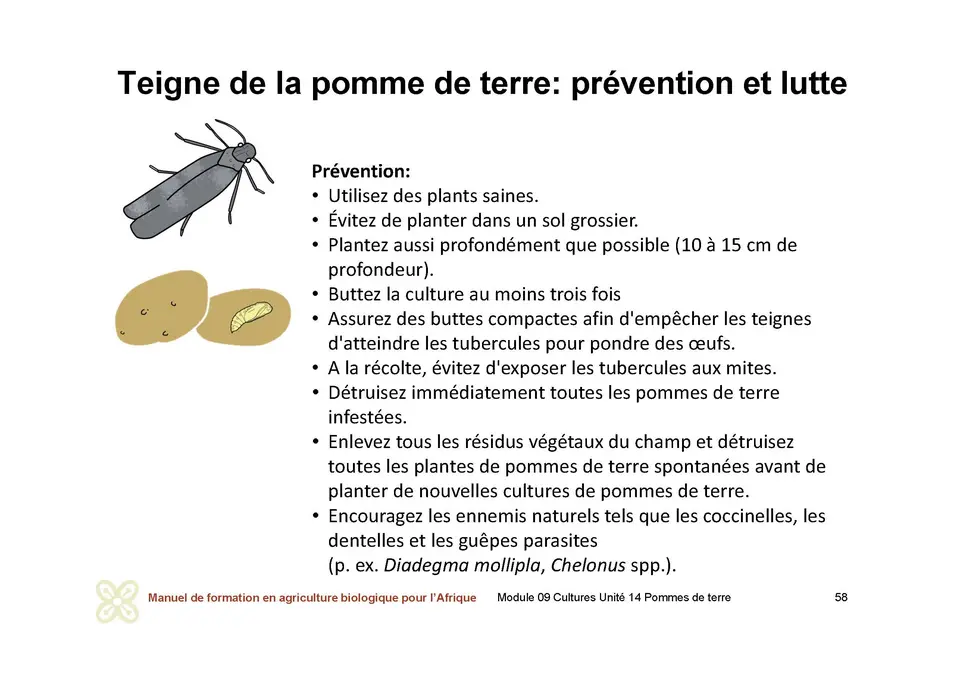
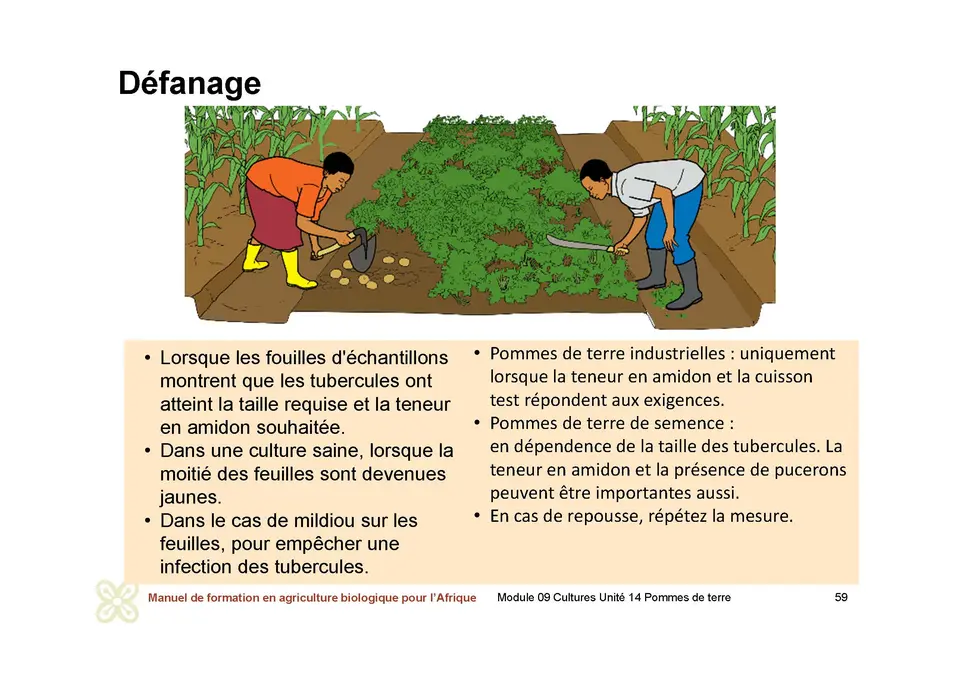
 Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?
Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?